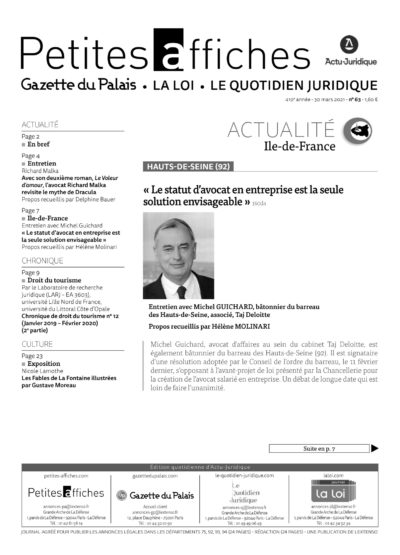Chronique de droit du tourisme n° 12 (Janvier 2019 – Février 2020) (2e partie)
Attentats, grèves, mouvement des « gilets jaunes », niveau de délinquance, incendie de la cathédrale de Paris, propagation apparemment incontrôlable de l’épidémie liée au Coronavirus (Covid-19), perspective du Brexit… Nombreux sont les événements qui auraient pu cette année encore avoir un impact sur le tourisme en France. L’année 2019 paraît pourtant avoir été de nouveau une bonne année pour le tourisme français, même si les chiffres officiels sur l’année ne sont pas encore disponibles. L’activité touristique semble davantage impactée par son encadrement juridique, lequel continue de nécessiter le recours à de nombreux droits, malgré la promulgation d’un Code du tourisme en 2016.
I – Les acteurs du tourisme
A – Acteurs publics
B – Acteurs privés
II – Activités du tourisme
A – Exercice des activités touristiques
1 – Financement des activités
(…)
2 – Libertés de circulation
(…)
3 – Intermédiaires de voyages
L’obligation d’information sur les formalités administratives à accomplir en cas de franchissement de frontières est une obligation précontractuelle (Cass. 1re civ., 27 mars 2019, n° 17-31319). Un arrêt rendu par sa première chambre civile le 27 mars 2019 donne l’occasion à la Cour de cassation de préciser les limites de l’obligation d’information de l’agence de voyages.
Les faits étaient des plus banals : une femme avait conclu par internet un contrat ayant pour objet un séjour comprenant un vol aller-retour Genève-New York et trois nuits d’hôtel à New York. Elle ne peut pas embarquer à destination de cette ville parce qu’elle ne disposait pas de l’autorisation de voyage de type ESTA, exigée par les autorités américaines pour se rendre sur le territoire des États-Unis. Elle intente donc une action contre son vendeur en paiement de différentes indemnités.
La cour d’appel accueille sa demande. Elle constate que la cliente avait été informée par écrit, par le vendeur, des formalités à accomplir pour entrer sur le territoire des États-Unis, mais que ces formalités ne lui ont pas été rappelées avant la date de départ, et que les billets électroniques qui lui ont été envoyés indiquaient : « pour les enregistrements sur place, veuillez respecter l’heure du rendez-vous afin d’accomplir dans les temps les formalités d’enregistrement et de police », ce qui aurait constitué une information insuffisante.
L’arrêt est pourtant cassé : après avoir visé l’article L. 211-8 du Code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) n° 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, l’article R. 211-4, 5°, dudit code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l’application de ladite ordonnance, et l’article R. 211-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 portant coordination des textes réglementaires avec l’ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, la Cour de cassation précise que « le vendeur de prestations de voyages ou de séjours informe le consommateur par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, des formalités administratives à accomplir par celui-ci en cas de franchissement des frontières ». Mais l’obligation de l’agence de voyages se limite à cela : elle n’est pas tenue de rappeler à sa cliente, après la conclusion du contrat, les formalités administratives à accomplir par celle-ci en cas de franchissement des frontières.
La solution constitue une application littérale des textes précités : l’article L. 211-8 du Code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2017, disposait effectivement que le vendeur informe les intéressés « préalablement à la conclusion du contrat », notamment « des formalités à accomplir en cas de franchissement de frontières ». L’article R. 211-4, 5° du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, ajoutait que, « préalablement à la conclusion du contrat », le vendeur devait communiquer cette même information, ce qui signifie que cette obligation constituait une obligation de nature précontractuelle. Et l’on ne trouvait aucune exigence comparable après cette période. En effet, si les articles L. 211-10 et R. 211-6, dans leur rédaction applicable à la cause, prévoyaient que le contrat de vente de voyages à forfait devait être rédigé par écrit et comporter un certain nombre de mentions obligatoires, les informations sur les formalités à accomplir en cas de franchissement des frontières ne figuraient pas parmi ces mentions.
Cela peut paraître rigoureux. En effet, s’il ne faut pas protéger à outrance les voyageurs, et que l’on peut admettre qu’un voyageur informé au moment de la formation du contrat des formalités de franchissement des frontières est un voyageur suffisamment informé, celui-ci pouvant ensuite faire preuve d’un minimum de vigilance et prendre la peine de se reporter aux informations reçues à ce moment-là s’il a un doute au moment du départ, il ne paraît pas excessif de se dire que l’information en question doit être reprise dans le document retraçant le contenu du contrat, dont le voyageur peut raisonnablement considérer qu’il constitue le document auquel il doit se référer s’agissant de son voyage.
La solution sera à ce titre moins pénalisante pour le voyageur depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 et du décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017. En effet, depuis l’entrée en vigueur de ces textes, l’article L. 211-8 précise que l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur, (…) préalablement à la conclusion du contrat, (notamment) des conditions de franchissement des frontières ». Et l’article L. 211-10 prévoit que « lors de la conclusion du contrat, ou dans les meilleurs délais par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable », et que le contrat ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l’article L. 211-8 », ainsi qu’un certain nombre d’informations complémentaires. Les articles R. 211-4 et R. 211-6, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1871, du 29 décembre 2019, reprennent ces obligations.
Cela signifie que l’information sur les formalités à réaliser en cas de franchissement de frontières doit désormais être transmise à la fois avant la formation du contrat, mais également au moment de cette formation, voire plus tard, si la conclusion du contrat ne s’est pas accompagnée de la remise immédiate d’une confirmation du contrat sur un support durable. En effet, dans ce cas, l’information devra être réitérée au moment de la fourniture de cette confirmation. Les voyageurs auront ainsi la certitude de disposer de cette information fondamentale dans le document retraçant le contenu de leur contrat, ce qui semble raisonnable.
Mais le voyageur doit être attentif à ce qui est indiqué dans son contrat, car l’organisateur ou le détaillant n’a a priori toujours aucune obligation de lui rappeler les formalités à accomplir pour franchir les frontières au moment du départ. Il n’en va autrement que lorsque les informations qu’il aurait délivrées une première fois seraient devenues obsolètes, puisque, dans ce cas, il devrait transmettre à son client des informations actualisées.
Sophie MOREIL
Partir ou être indemnisé, il faut choisir (Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21203, PB ; Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21204, PB). Lorsque le vendeur d’un voyage à forfait annule un voyage, l’acheteur peut-il à la fois accepter un voyage de substitution et réclamer le paiement de l’indemnité forfaitaire mise, par l’article R. 211-10 du Code du tourisme, à la charge du vendeur qui résilie le contrat sans faute de l’acheteur ? Telle est la question à laquelle a dû répondre la Cour de cassation dans deux arrêts rendus par sa première chambre civile le 14 novembre 2019 et promis à une large diffusion.
Dans les deux affaires, une personne avait réservé un séjour dans un village-vacances au Maroc. Dans les deux cas, le vendeur annule le voyage la veille du départ, mais propose à la place un séjour dans un village-vacances en Égypte aux mêmes dates que celui réservé initialement1. Le prix du voyage de substitution est fixé, après une réduction et un avoir d’un montant total de 8 155 €, à 16 393,88 €, ce qui correspond approximativement au prix du séjour au Maroc. À chaque fois, l’acheteur accepte la proposition. Mais, à l’issue du voyage, il assigne le vendeur en paiement d’une indemnité sur le fondement des articles L. 211-14 et R. 211-10 du Code du tourisme, dans leur rédaction antérieure à la réforme opérée par l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 et ses décrets d’application.
Le premier de ces textes prévoyait en effet, dans la rédaction applicable à la cause, que, lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat sans qu’il y ait eu une faute de l’acheteur, ce vendeur doit restituer à son cocontractant la totalité des sommes versées par lui, et ce, « sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre ». Le deuxième ajoutait que, dans ce cas, le vendeur doit informer l’acheteur ; et que, l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date (C. tourisme, art. R. 211-10, al. 1er). Un alinéa 2 ajoutait que ces dispositions « ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur ».
Dans chacune des deux affaires, la cour d’appel déboute l’acheteur de ses demandes. Elle considère que, puisqu’il avait accepté le voyage de substitution proposé par le vendeur, il ne pouvait pas réclamer l’indemnité prévue par le premier alinéa de l’article R. 211-10.
Les pourvois formés par les voyageurs dans ces deux affaires tentaient de faire admettre les mêmes arguments : ils soutenaient que l’indemnité de résiliation prévue par l’article R. 211-10 du Code du tourisme reste due à l’acheteur même lorsqu’il a accepté le voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Ils tentaient également de faire admettre que si l’acceptation d’un tel voyage pouvait priver l’acheteur de l’indemnité de résiliation, c’était uniquement à la condition que l’indemnisation accordée à l’acheteur dans le cadre de l’accord amiable ait été au moins égale au montant de l’indemnité de résiliation qu’il aurait perçue si aucun accord amiable n’avait été conclu. Ils affirmaient aussi qu’il pouvait être privé de l’indemnité uniquement s’il avait clairement manifesté son intention de renoncer au versement de cette indemnité. Ils ajoutaient enfin qu’il ne pouvait par ailleurs en être privé que si les modalités contractuelles de conclusion d’un accord amiable de substitution avaient été respectées. Or on ne se serait situé dans aucune de ces hypothèses.
Mais ces arguments sont écartés. La Cour de cassation rejette en effet le pourvoi formé dans chacune de ces affaires : après avoir rappelé le contenu des deux textes en cause, elle approuve la cour d’appel d’avoir considéré que l’acheteur qui avait accepté le voyage de substitution proposé par le vendeur ne pouvait pas réclamer à ce dernier l’indemnité prévue au premier alinéa de l’article R. 211-10 du Code du tourisme. L’accord amiable par lequel l’acheteur accepte un voyage ou un séjour de substitution prévu par l’alinéa 2 de l’article R. 211-10 écarte donc le droit à l’indemnité forfaitaire prévu par l’alinéa 1er du même article.
Cela s’explique certainement par le fait que, l’indemnité ayant pour objet d’assurer le respect de l’obligation souscrite par le vendeur de ce voyage2, elle n’a plus lieu d’être lorsque l’obligation initiale est éteinte, et remplacée par une autre avec l’accord de l’acheteur.
Reste à savoir par quel mécanisme s’opère ce remplacement. Certains ont pu suggérer qu’il s’agirait d’une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil3, définie comme un « contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître » (C. civ., art. 2044, réd. L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016). Mais, comme cela a pu être relevé par un auteur4, il n’y a ici pas nécessairement de concessions réciproques, alors que l’existence de concessions réciproques a toujours été retenue comme constituant un critère de qualification de la transaction. On peut se demander s’il ne faut pas plutôt y voir une novation. Celle-ci correspond en effet à « l’opération juridique par laquelle les parties décident de substituer une obligation nouvelle à une obligation préexistante, qui est corrélativement éteinte »5. Or c’est exactement ce qui se passe ici : l’obligation de fournir le premier voyage est éteinte. Et, à la place, naît celle de fournir un nouveau voyage.
Quoi qu’il en soit, la solution est opportune. D’une part, il aurait été difficilement compréhensible que les voyageurs, qui avaient pu en l’espèce partir aux dates initialement prévues et avaient été surclassés, puisqu’ils avaient pu payer un prix quasiment identique à celui initialement prévu pour bénéficier d’un voyage de plus haut de gamme, après avoir bénéficié d’un avoir de plus de 8 000 €, puissent encore réclamer une indemnité supplémentaire. D’autre part, cela peut inciter les vendeurs à proposer des voyages de substitution pour échapper à l’obligation de verser l’indemnité forfaitaire.
Une fois cette première affirmation réalisée, la Cour de cassation tire les conséquences de ses premières analyses. Elle retient que, à partir du moment où l’indemnité est exclue en cas d’acceptation d’un voyage de substitution, la cour d’appel n’avait pas à caractériser la volonté de l’acheteur d’y renoncer. Elle ajoute que la cour d’appel a par ailleurs justement déduit du fait que l’acheteur avait accepté le voyage de substitution avec un départ à la même date que le voyage initialement prévu et qu’il avait ainsi renoncé à se prévaloir du délai contractuel de réflexion.
On peut toutefois se demander si la solution aurait été la même si la Cour de cassation avait eu à appliquer les mêmes articles dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 et du décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017. En effet, l’article L. 211-14 du Code du tourisme dispose désormais que : « III. – L’organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n’est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si » le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans un certain délai, ou si l’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et qu’il notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour. Il n’est pas question de l’acceptation d’un voyage de substitution. Et l’article R. 211-10 ne traite pas davantage de cette question.
Cela ne veut bien évidemment pas dire que le voyageur ne pourra plus accepter de voyages de substitution par accord amiable. Le principe de la liberté contractuelle, à lui seul, permet de fonder une telle acceptation. Mais il n’est pas certain que le vendeur puisse continuer à échapper à l’obligation de payer une indemnité du simple fait que ce voyageur aurait accepté un voyage de substitution. Il semblerait qu’il ne soit dispensé de la payer que lorsque l’annulation du voyage aura eu pour motif l’une des deux causes expressément prévues par l’article L. 211-14.
Cela s’avérera sans doute moins protecteur des voyageurs, ne serait-ce que parce que le vendeur n’aura plus besoin de proposer de voyage de substitution pour échapper à l’indemnité lorsque l’annulation sera fondée sur l’un de ces cas.
Sophie MOREIL

4 – Transports
Un important revirement concernant l’effet exonératoire de la faute de la victime en matière de transport ferroviaire (Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-13840, PBRI)6. Avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, la jurisprudence considérait que le transporteur ferroviaire était tenu, vis-à-vis de ses voyageurs, d’une obligation de sécurité de résultat7 qui courait du moment où le voyageur montait dans le train, pour prendre fin à celui où il achevait d’en descendre8.
Et alors que, traditionnellement, ce transporteur ferroviaire pouvait, comme tout débiteur d’une obligation de résultat, revendiquer le bénéfice des causes d’exonération de droit commun que sont la force majeure, la faute de la victime ou le fait d’un tiers, et que ces deux dernières causes d’exonération pouvaient, conformément aux solutions de droit commun, lui permettre d’écarter soit totalement, soit partiellement sa responsabilité, selon la part prise par ces causes d’exonération dans la survenance du dommage9, la Cour de cassation a fini par décider, en 2008, que celles-ci ne pouvaient être invoquées utilement par le transporteur ferroviaire que si elles étaient de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité10. À défaut, il était considéré comme entièrement responsable du préjudice subi par le voyageur. Cela constituait une solution extrêmement protectrice de ce dernier, qui pouvait rechercher la responsabilité du transporteur ferroviaire et être indemnisé de la totalité de son préjudice alors même qu’il avait pris part à la survenance de son dommage.
Mais cette solution, qui était propre au transport ferroviaire intérieur, puisque la Cour de cassation avait refusé de l’étendre au transport international11, était à la fois contraire au droit commun des obligations et aux solutions issues du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, pourtant entré en vigueur le 3 décembre 2009, sans dérogation possible s’agissant des dispositions qu’il renferme concernant la responsabilité du transporteur vis-à-vis de ses passagers (règl. (CE) n° 1371/2007, art. 2, 3°). Elle ne pouvait donc pas être maintenue. La Cour de cassation a, de ce fait, fini par opérer un revirement par un arrêt rendu par sa première chambre civile le 11 décembre 2019.
Les faits étaient les suivants : une passagère avait été victime d’un écrasement du pouce gauche à la suite de la fermeture d’une porte automatique du train dans lequel elle voyageait. Elle intente donc une action en responsabilité contre la société SNCF mobilités.
La cour d’appel fait droit à sa demande et condamne la SNCF à réparer l’entier préjudice subi par elle. Elle refuse en effet de faire application du règlement européen. Elle s’appuie pour cela sur le fait que l’article 11 du règlement prévoit que la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le règlement sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, et considère que la jurisprudence de la Cour de cassation retenant que seule la faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure peut être opposée à cette victime est plus favorable à la victime, de sorte qu’elle doit prévaloir.
Mais ce raisonnement, critiqué par le pourvoi formé par la SNCF, est censuré par la Cour de cassation. En effet, après avoir visé les articles 11 du règlement (CE) n° 1371/2007, et 26 de son annexe I, l’article L. 2151-1 du Code des transports et 1147 du Code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et rappelé la jurisprudence issue des arrêts de 200812, la Cour précise que, aux termes de l’article 11 du règlement, « sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le titre IV, chapitres I, III et IV, ainsi que les titres VI et VII de l’annexe I du règlement (CE) n° 1371/2007 », et que, selon l’article 26 de son annexe I, « le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée. Il est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où l’accident est dû à une faute du voyageur ». Elle ajoute que ces dispositions du droit de l’Union, entrées en vigueur le 3 décembre 2009, sont reprises à l’article L. 2151-1 du Code des transports, lequel dispose que le règlement (CE) n° 1371/2007 s’applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive n° 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, qu’il en « résulte que le transporteur ferroviaire peut s’exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l’accident est dû à une faute de celui-ci, sans préjudice de l’application du droit national en ce qu’il accorde une indemnisation plus favorable des chefs de préjudices subis par la victime », et qu’il y a donc lieu de modifier sa jurisprudence. La faute de la victime est donc à nouveau susceptible de constituer une cause d’exonération aussi bien partielle que totale de la responsabilité du transporteur ferroviaire.
Le revirement était prévisible. La jurisprudence de 2008 semblait difficilement justifiable au regard du droit commun des obligations, et elle se combinait mal avec le règlement européen, dont la Cour de cassation a donc définitivement cessé de différer l’application : puisque ce règlement admet que la faute de la victime puisse ne constituer qu’une cause d’exonération partielle de la responsabilité du transporteur ferroviaire, et qu’il n’autorise les dérogations aux règles relatives à la responsabilité qu’il instaure qu’en ce qui concerne l’indemnisation des dommages subis, et non au sujet des conditions de la responsabilité, la jurisprudence antérieure devait être abandonnée.
De la décision de la Cour de cassation, on comprend par ailleurs, que, pour savoir si le droit français peut être maintenu en ce qu’il était plus favorable aux victimes que le droit européen, il convient de distinguer entre, d’une part, les conditions de mise en jeu de la responsabilité du transporteur, parmi lesquelles on intégrera les faits générateurs et les causes d’exonération, pour lequel, il est interdit de déroger au règlement européen, et, d’autre part, l’indemnisation, c’est-à-dire le montant des dommages et intérêts octroyés une fois les conditions de mise en jeu de la responsabilité du transporteur réunies, pour lequel il est permis aux législateurs nationaux d’accorder aux victimes des solutions plus avantageuses que celles offertes par le règlement13. Et, à ce propos, la Cour de cassation semble retenir une conception plus restrictive que celle qu’imposerait la lettre du règlement de ce que recouvre « l’indemnisation », puisqu’elle précise que les dérogations ne sont possibles que s’agissant des « chefs de préjudice »14, formule dont il faudra attendre d’autres décisions pour comprendre ce qu’elle signifie exactement dans l’esprit de la Cour de cassation.
Cette décision présente en tout cas le mérite d’unifier le régime applicable aux causes d’exonération de la responsabilité du transporteur ferroviaire, et de faire cesser une exception critiquée aux règles issues du droit commun des obligations.
Sophie MOREIL
Le voyageur sans billet est encore un voyageur ferroviaire (CJUE, 5e ch., 7 nov. 2019, nos C-349/18, C-350/18 et C.-351/18). Un contrat peut se nouer entre un transporteur ferroviaire et un voyageur dépourvu de titre de transport. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans une décision rendue le 7 novembre 2019 à la suite d’une question préjudicielle posée par un juge belge dans le cadre d’un litige opposant la Société des chemins de fer belges (SNCB) à plusieurs ressortissants belges qui avaient voyagé à plusieurs reprises sans billet.
La SNCB avait offert à chacun de ces passagers la possibilité de régulariser sa situation en s’acquittant soit immédiatement du prix du trajet, augmenté de la majoration dite de « tarif à bord », soit, dans les 14 jours du constat de l’infraction, d’un montant forfaitaire de 75 € ou, pour les infractions antérieures à l’année 2015, du prix du transport majoré de 60 €. Après l’écoulement de ce délai de 14 jours, les voyageurs avaient encore la possibilité de payer un montant forfaitaire de 225 € ou, pour les infractions antérieures à l’année 2015, le prix du transport majoré de 200 €.
Aucun des passagers n’ayant régularisé sa situation, la SNCB les assigne en justice, pour obtenir le paiement du prix du transport à une somme majorée. Le juge saisi s’interroge alors sur le point de savoir si les dispositions prévoyant que des suppléments de prix seraient exigés par le transporteur ferroviaire de ses passagers qui n’ont pas acheté leur billet avant de monter dans le train, ni régularisé leur situation, sont soumises aux règles relatives aux clauses abusives.
La réponse dépendant du point de savoir si un contrat avait été conclu malgré l’absence de titre de transport, le juge forme une question préjudicielle auprès de la CJUE, notamment pour savoir, en substance, si une relation contractuelle, au sens du règlement (CE) n° 1371/2007 sur les droits et devoirs des voyageurs ferroviaires naît nécessairement entre une société de transport et un voyageur qui emprunte ses trains, y compris lorsqu’il voyage sans billet.
La CJUE considère que tel est le cas. Après avoir reformulé la question, elle indique que, dans la mesure où un voyageur qui ne présente pas de titre de transport valable ou refuse le paiement immédiat du titre de transport peut se voir opposer, en vertu de l’article 9 de l’appendice A de la COTIF, figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 1371/2007, les conditions générales de transport, et dans la mesure où celles-ci, selon l’article 3, point 16, de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 3, point 2, de celui-ci, deviennent, aux fins dudit règlement, partie intégrante du contrat de transport entre l’entreprise ferroviaire et le voyageur par la conclusion de celui-ci, il en résulte qu’une telle entreprise qui laisse un libre accès à ses trains et un voyageur qui monte à bord d’un tel train en vue d’effectuer un trajet doivent être considérés comme étant parties à un « contrat de transport », au sens du même règlement, dès que ce voyageur se trouve ainsi à bord du train. En effet, dans le cas contraire, ledit voyageur ne saurait, sur la base du règlement (CE) n° 1371/2007, se voir opposer ces conditions générales de transport. Selon la Cour, il découle clairement de ces éléments que le billet n’est que l’instrument qui matérialise le contrat de transport, au sens du règlement (CE) n° 1371/2007.
La solution diverge avec celle traditionnellement retenue par la Cour de cassation. Celle-ci considérait en effet, jusqu’à présent, qu’aucun contrat ne pouvait se nouer entre un voyageur dépourvu de billet et le transporteur ferroviaire. C’est ce qui lui permettait de refuser à ce voyageur la possibilité d’invoquer l’obligation contractuelle de sécurité de résultat dont peut se prévaloir le voyageur muni d’un billet15, et de décider que, à son égard, la responsabilité de la SNCF ne pouvait être recherchée que sur le fondement extracontractuel. La même solution a d’ailleurs été retenue à propos d’un voyageur qui avait bien un billet, mais qui s’était trompé de direction16, ou d’un autre qui avait poursuivi son trajet après sa gare d’arrivée17.
Il faudra donc désormais abandonner cette solution, au moins pour ce qui relève du règlement européen, et admettre qu’un contrat se noue avec le transporteur ferroviaire, y compris lorsqu’un voyageur monte délibérément sans billet.
Faut-il le déplorer ? La solution antérieure n’était pas parfaitement convaincante. En effet, le contrat de transport ferroviaire est a priori un contrat consensuel, qui se forme par le seul échange des consentements, et le billet ne constitue qu’une preuve de ce contrat18, de sorte qu’il pouvait paraître erroné de dire qu’il ne peut pas y avoir de contrat lorsque le voyageur est dépourvu de billet19, comme de faire de l’absence de paiement du prix20 – élément relatif, non à la formation, mais à l’exécution du contrat21 – le signe de l’absence de contrat. Cela ne correspond d’ailleurs pas à l’analyse que semble en faire le juge administratif, qui considère que le voyageur qui n’a pas encore acquitté le prix du billet, a la qualité d’usager d’un service public industriel et commercial22.
On remarquera toutefois que, pour appuyer son raisonnement, la CJUE se fonde notamment sur le fait que l’entrepreneur de transport laissait un libre accès à ses trains. On peut se demander si la solution serait la même s’agissant, par exemple, de la SNCF, qui installe des portiques de contrôle d’accès au train, de manière à éviter que des personnes non munies d’un billet accèdent au quai, fussent-elles, d’ailleurs, des personnes simplement venues accompagner les voyageurs. Il est en effet difficile de dire qu’elle est en état d’offre permanente, de sorte que quiconque monte dans le train, y compris quelqu’un qui parviendrait à éviter les contrôles et à monter sans billet, noue avec elle un contrat de transport.
Sophie MOREIL
5 – Hébergements touristiques (…)
6 – Tourisme collaboratif (…)
7 – Responsabilités et assurances
La détermination de la juridiction compétente à l’épreuve de la diversité des instruments (CJUE, 7 nov. 2019, n° C-213/18, Adriano Guaitoli et a. c/ EasyJet Airline Co. Ltd). Le développement du contentieux drainé par la mise en œuvre des différentes protections offertes aux passagers du transport aérien en a peu à peu révélé sa variété. Des questions probatoires comme procédurales sont progressivement venues enrichir le contentieux classique dédié à l’application des droits reconnus aux passagers victimes de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol. À ce titre, il est intéressant de noter la place croissante que prennent les interrogations relatives à la détermination de la juridiction compétente pour connaître des demandes d’indemnisation formulées par les passagers de transport aérien23. L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 7 novembre 201924 en fournit une illustration topique.
Le contentieux a pour origine l’exécution défectueuse d’un contrat de transport conclu avec la société EasyJet Airline, dont le siège social est fixé au Royaume-Uni. Ce contrat comprenait un vol aller-retour entre Rome Fiumicino (Italie) et Corfou (Grèce). Le vol aller prévu pour le 4 août 2015, avec un départ programmé à 20 h 20, a un premier temps été annoncé comme retardé pour ensuite être annulé. Il a en définitive été assuré le lendemain de la date prévue, sans que le transporteur aérien ait proposé aux passagers victimes de mesures d’assistance et/ou d’indemnisation. Le vol de retour a, quant à lui, subi un retard de plus de 2 heures et de moins de 3 heures. Conformément à une jurisprudence aujourd’hui acquise, les passagers victimes de ces différents manquements au contrat de transport ont engagé deux actions afin d’obtenir réparation de leur entier préjudice. L’une de ces actions est fondée sur les articles 5, 7 et 9 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/9125. En d’autres termes sont invoqués les droits d’assistance, de prise en charge et d’indemnisation reconnus aux passagers victimes d’annulation ou de retard important de vol. L’autre est fondée sur l’article 19 de la convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international26. Cette seconde action vise à obtenir la réparation de dommages matériels supplémentaires et de préjudices moraux causés par le manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles.
L’affaire est initialement portée devant la juridiction italienne du lieu de domiciliation des passagers victimes, demandeurs à l’action (Rome). L’exception d’incompétence soulevée par le transporteur aérien va alors fournir à la juridiction italienne l’occasion de formuler trois questions préjudicielles 27.
La première question concerne la détermination du texte permettant de déterminer la juridiction compétente pour connaître des demandes conjointes formulées par les passagers victimes d’une annulation ou d’un retard important de vol.
La Cour de justice de l’Union européenne28 répond à cette question en deux temps.
La réponse apportée par la Cour est en effet précédée d’observations liminaires. La Cour y indique que, malgré la formulation de la question préjudicielle29, les dispositions applicables ratione temporis sont celles du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale30.
Ensuite, la Cour indique que la question qui lui est posée revient à déterminer si la juridiction territorialement compétente doit être déterminée en application du règlement (UE) n° 1215/201231 concernant la demande fondée sur « des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le règlement (CE) n° 261/2004 »32 et en application de l’article 33 de la convention de Montréal du 28 mai 1999 en ce qui concerne la demande de réparation « d’un préjudice complémentaire relevant du champ d’application de la convention de Montréal »33.
Or le choix de l’instrument applicable n’est pas sans conséquence, dans la mesure où les règles de détermination de la juridiction territorialement compétente retenues par chacun de ces textes sont, au moins pour partie, différentes. L’article 33 de la convention de Montréal du 28 mai 1999 consacre une option au bénéfice du demandeur à l’action en responsabilité exercée contre le transporteur. Le demandeur peut selon son choix porter son action « dans le territoire d’un des États parties » devant quatre juridictions différentes : soit le tribunal du domicile du transporteur, celui du siège principal de son exploitation ou celui du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu ; soit le tribunal du lieu de destination. Le règlement (UE) n° 1215/2012 consacre un système de solutions organisé autour d’une règle de compétence de principe et de règles de compétences spéciales34. Dans ce cadre, la juridiction territorialement compétente est en principe la juridiction du lieu du domicile du défendeur35. Des règles de compétences spéciales sont ensuite prévues. À ce titre, en matière contractuelle, l’article 7, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 retient que le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait « devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande »36.
Pour répondre à la première question, la Cour fait le choix de maintenir l’autonomie de chaque instrument normatif invoqué. La Cour retient en effet qu’en présence de droits reconnus dans des cadres réglementaires distincts, les règles de détermination d’une compétence internationale doivent être déterminées en faisant une application distributive des textes en cause37. Aussi, la compétence de la juridiction saisie d’une demande fondée sur le règlement (CE) n° 261/2004 doit être appréciée au regard du règlement (UE) n° 1215/2012. En revanche, la compétence de la juridiction saisie d’une demande fondée sur les dispositions de la convention de Montréal du 28 mai 1999 – comme l’article 1938 – doit être appréciée au regard de l’article 33 de ce texte.
La seconde question dont est saisie la CJUE concerne la portée de l’article 33, § 1, de la convention de Montréal du 28 mai 1999. Il s’agit plus précisément de déterminer si cette disposition régit uniquement la répartition de la compétence judiciaire entre les États parties à la convention ou si elle régit également la répartition de la compétence territoriale entre les juridictions de chacun de ces États. La CJUE opte sans détour pour la seconde solution : « L’article 33, paragraphe 1, de la convention de Montréal doit être interprété en ce sens qu’il régit, aux fins des actions en réparation d’un préjudice relevant du champ d’application de cette convention, non seulement la répartition de la compétence judiciaire entre les États partie à celle-ci, mais également la répartition de la compétence territoriale entre les juridictions de chacun de ces États »39.
Au terme de cet arrêt, l’on comprend notamment que la diversité des instruments permettant la détermination de la juridiction territorialement compétente fait écho à celle des instruments de protection. Or cette diversité ne sera sans doute pas de nature à simplifier la mise en œuvre des droits reconnus aux passagers victimes d’une annulation et d’un retard important de vol, sauf à ce que certaines règles de détermination de la juridiction territorialement compétente soient communes aux deux textes.
Valérie DURAND
Le droit au remboursement en cas d’annulation d’un vol compris dans un forfait touristique ou l’articulation des dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 avec celles de la directive n° 90/315/CEE relative au voyage à forfait (CJUE, 10 juill. 2019, n° C-163/18, HQ e.a. c/ Aegean Airlines SA)40. Si la question de la coordination des protections des passagers du transport aérien apparaît comme une question cardinale, elle est bien souvent abordée sous l’angle de l’articulation des dispositions de la convention de Montréal 28 mai 1999 avec celles du règlement (CE) n° 261/2004. Or comme en témoigne l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 10 juillet 2019, une question similaire peut se poser lorsque sont mises en présence d’une part les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 et d’autre part celles de la directive n° 90/315/CEE relative au voyage à forfait.
L’affaire concernait un forfait touristique acheté le 19 mars 2015 auprès d’une agence de voyages. Le forfait comprenait des billets d’avion aller-retour Eelde (Pays-Bas)-Corfou (Grèce), les vols étant respectivement programmés pour les 17 et 24 juillet 2015. Quelques jours avant le départ, l’agence de voyages informe ses clients qu’elle est contrainte d’annuler les vols convenus avec le transporteur aérien, ce dernier ayant décidé de ne plus assurer de vols à destination et en provenance de Corfou à compter du 17 juillet 201541. Le 3 août 2016, l’agence de voyages est déclarée en faillite.
Les voyageurs victimes de l’annulation de vol ont donc saisi une juridiction des Pays-Bas afin d’obtenir d’une part l’indemnisation due en raison de l’annulation du vol du 17 juillet 2015 et d’autre part, le remboursement des billets. Pour ce faire, ils fondent leurs demandes sur les articles 5, § 1 et 8, § 1, sous a), du règlement (CE) n° 261/2004. Le transporteur riposte en invoquant, sur le fondement de l’article 342, § 6 de ce même texte43, l’inapplicabilité du règlement au profit des dispositions de la directive n° 90/314/CEE sur les voyages à forfait.
Devant la juridiction des Pays-Bas, les passagers victimes obtiennent la condamnation du transporteur aérien au paiement d’une indemnisation. La demande de remboursement des billets d’avion donne lieu, quant à elle, à la formulation de deux questions préjudicielles.
La première question préjudicielle concerne la coordination du règlement (CE) n° 261/2004 avec les dispositions de la directive n° 90/314/CEE. Plus précisément, il s’agit de déterminer si l’article 8, § 2, du règlement (CE) n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un passager qui dispose, au titre de la directive n° 90/314/CEE sur les voyages à forfait, du droit de s’adresser à son organisateur de voyages pour obtenir le remboursement de son billet ne peut plus réclamer aucun remboursement au transporteur aérien sur le fondement du règlement.
À cette question, la CJUE répond par l’affirmative44. Pour ce faire, la CJUE procède à deux rappels.
Tout d’abord la lecture combinée des articles 8, § 1, sous a) et 5, § 1, sous a) du règlement (CE) n° 261/2004 conduit à retenir qu’il « incombe au transporteur aérien, en cas d’annulation d’un vol, d’offrir aux passagers concernés une assistance consistant à leur proposer, notamment le remboursement de leur billet »45.
Ensuite, l’article 8, § 2, de ce même texte procède à la coordination du droit au remboursement de billets qu’il consacre avec celui reconnu par la directive n° 90/314/CEE aux voyageurs victimes d’une annulation du forfait touristique.
Et la CJUE de poursuivre, en relevant que si le règlement (CE) n° 261/2004 reconnaît bien un droit au remboursement de leurs billets aux passagers victimes d’une annulation de vol, y compris lorsque le vol est inclus dans un forfait touristique46, il en va différemment lorsqu’un droit au remboursement découle de la directive n° 90/314/CEE elle-même. La Cour retient en effet que « la simple existence d’un droit au remboursement, découlant de la directive n° 90/314/CEE suffit à exclure qu’un passager, dont le vol fait partie d’un voyage à forfait, puisse réclamer le remboursement de son billet, en vertu du règlement (CE) n° 261/2004, auprès du transporteur aérien effectif »47. Ce faisant, la CJUE ferme résolument la porte à une application cumulative des deux instruments en cause, application aboutissant à reconnaître à l’acquéreur d’un forfait touristique deux droits au remboursement – l’un découlant du règlement (CE) n° 261/2004 et l’autre de la directive n° 90/314/CEE – qu’il pourrait exercer simultanément. Est également écartée la solution consistant à reconnaître au voyageur une option entre l’un ou l’autre des instruments, option qui lui aurait permis d’exercer son droit au remboursement selon son choix contre le transporteur aérien ou l’agence de voyages48.
Sous l’angle du droit au remboursement, le règlement (CE) n° 261/2004 et la directive n° 90/314/CEE s’appliquent donc de manière alternative. De deux choses l’une : soit le passager dispose d’un droit au remboursement de son billet sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 et il peut l’exercer contre le transporteur aérien ; soit il dispose d’un droit similaire sur le fondement de la directive n° 90/314/CEE et il peut le faire valoir contre l’organisateur du forfait touristique. La CJUE fonde cette lecture stricte de l’article 8, § 2 du règlement (CE) n° 261/2004 notamment sur la volonté du législateur européen telle qu’elle ressort des travaux préparatoires du règlement (CE) n° 261/200449 ainsi que sur les conséquences attachées à un éventuel cumul des droits au remboursement dans l’hypothèse de l’annulation d’un vol contenu dans un forfait touristique.
La seconde question préjudicielle s’inscrit dans le prolongement de la première question. Il est en effet demandé à la CJUE de déterminer si les dispositions en cause peuvent être interprétées comme permettant de reconnaître au voyageur un recours en remboursement, par hypothèse exceptionnel, contre le transporteur aérien lorsque l’agent de voyages responsable est « dans l’incapacité financière de rembourser le billet » et « n’a pris aucune mesure de garantie ».
La réponse est sur ce point négative. Le passager qui dispose d’un droit au remboursement contre l’organisateur de voyages en application de la directive n° 90/314/CEE ne peut solliciter ce même remboursement sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 contre le transporteur lorsque « l’organisateur de voyages est dans l’incapacité financière d’effectuer le remboursement du billet et n’a pris aucune mesure afin de le garantir »50. La Cour avance deux arguments principaux au soutien de cette solution. Prenant une nouvelle fois appui sur la clarté du libellé de l’article 8, § 2 du règlement (CE) n° 261/2004, elle retient qu’il « n’est pas pertinent de savoir si l’organisateur de voyages est dans l’incapacité financière d’effectuer le remboursement du billet, s’il a pris ou non une mesure afin de garantir ce remboursement, ou encore si ces circonstances mettent en péril l’exécution de son obligation de rembourser les passagers concernés »51. Ensuite, la Cour souligne que cette interprétation « n’est pas infirmée » par l’objectif principal poursuivi par le règlement (CE) n° 261/2004, lequel consiste à « garantir un niveau élevé de protection des passagers ». La directive n° 90/314/CEE impose en effet à l’organisateur et/ou détaillant de justifier de garanties suffisantes52 permettant le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur en cas d’insolvabilité ou de faillite. La Cour rappelle d’ailleurs qu’il s’agit ici d’une véritable obligation de résultat53.
La solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne a sans doute le mérite de la clarté, d’autant qu’elle ne laisse la place à aucune atténuation ou exception. Elle contraste néanmoins avec les positions souvent plus protectrices des intérêts des passagers victimes d’une annulation ou d’un retard important de vol qu’elle a pu tenir par ailleurs54. En effet, dans le cas présent, les conséquences attachées à l’application distributive des deux textes en cause conduit à faire supporter aux passagers victimes le risque d’insolvabilité de l’organisateur du forfait touristique. La rigueur de cette solution doit toutefois être atténuée. La CJUE rappelle en effet que le passager dispose d’un moyen de défense pour peu qu’il déplace le contentieux sur le terrain de la transposition de la directive. Une directive est en effet considérée comme étant correctement transposée à condition que la réglementation nationale ait « pour résultat de garantir effectivement aux passagers le remboursement de tous les fonds qu’ils ont déposés en cas d’insolvabilité de l’organisateur de voyage »55. À défaut, le voyageur peut introduire une action en responsabilité contre l’État membre auteur de violation, cette action lui permettant d’obtenir réparation des dommages subis.
Valérie DURAND
(À suivre)
8 – Tourisme médical et tourisme procréatif
9 – Restauration
B – Aménagement des espaces à vocation touristique
Notes de bas de pages
-
1.
Les moyens annexés au pourvoi nous apprennent que l’annulation avait pour cause un incident électrique survenu à l’occasion des travaux de rénovation qui étaient en cours. Cette annulation n’a par ailleurs pas été annoncée conformément aux délais et selon les formes de prévenance requis.
-
2.
Cass. 1re civ., 4 nov. 1992, n° 90-21285 : Bull. civ. I, n° 278 ; D. 1993, p. 138, note Dagorne Labbe Y.
-
3.
Bon-Garcin I., note sous Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21203 : JCP 2020, 54 ; Gout O., Droit du transport de passagers, Droit français et de l’Union européenne, Bon-Garcin I. (dir.), 2016, Larcier, Paradigme, n° 211 ; Rép. com. Dalloz, v.°Agence de voyage, n° 49, obs. Dagorne-Labbé Y. ; Lachièze C., Droit du tourisme, 2014, LexisNexis, n° 347.
-
4.
Pellet J.-D., « Le régime général des obligations au service du droit du tourisme », D. 2020, p. 257, spéc. n° 3.
-
5.
Lequette Y., Terré F., Simler P. et Chénedé F., Droit civil – Les obligations, 12e éd., 2018, Dalloz, coll. Précis, n° 1710.
-
6.
AJCA 2020, p. 27, note Bucher C.-E. ; BTL 2019, p. 708, obs. Balat N. ; N3C 2020, n° 3, comm. 37, comm. Leveneur L. ; JCP G 2020, n° 10, note Delebecque P. ; JT 2020, p. 12, obs. Delpech X.
-
7.
Cette obligation, dégagée à propos du transport maritime, a été appliquée dès 1913 en matière de transport terrestre : Cass. civ., 27 janv. 1913 : S. 1913, 1, p. 117, concl. Sarrut L.
-
8.
Cass. 1re civ., 7 mars 1989, n° 87-11493, Valverde c/ SNCF : Bull. civ. 1989, I, n° 118 ; JCP G 1989, IV 176 ; LPA 4 mai 1990, p. 19, note Dagorne-Labbé Y. ; BTL 1989, p. 334, chron. Chao A. ; Gaz. Pal. 1989, 2, p. 632, note Paire G. ; D. 1989, inf. rap. p. 96 ; RTD civ. 1989, p. 548 et s., obs. Jourdain P.
-
9.
Cass. 1re civ., 20 oct. 1969 : Bull. civ. I, n° 300.
-
10.
Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 05-12551 : Contrats, conc. consom. 2008, comm. 173, note Leveneur L. ; JCP G 2008, II 10085, note Grosser P. ; D. 2008, p. 1582, note Viney G. ; RDC 2008, p. 743, obs. Mazeaud D. ; RTD civ. 2008, p. 312, obs. Jourdain P. V. aussi, mais à l’interprétation discutée, Cass. ch. mixte, 28 nov. 2008, n° 06-12307 : Bull. civ. ch. mixte, n° 3 ; Contrats, conc. consom. 2008, comm. 173, note Leveneur L. ; JCP G 2009, II 10011, note. Grosser P. ; D. 2008, p. 3079, note Gallmeister I. ; D. 2009, p. 461, note Viney G. ; Resp. civ. et assur. 2009, comm. 4, note Hocquet-Berg S. ; RTD civ. 2009, p. 129, obs. Jourdain P. ; RDC 2009, p. 487, obs. Genicon T. ; RTD civ. 2009, p. 129, obs. Jourdain P.
-
11.
Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 05-11800, Caisse nationale suisse c/ SNCF : Bull. civ. I, n° 77.
-
12.
Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 05-11800 et Cass. ch. mixte, 28 nov. 2008, n° 06-12307.
-
13.
En ce sens, v. not. Delebecque P., note sous Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-13840 : JCP G 2020, 10.
-
14.
V. Bucher C.-E., « Important revirement de jurisprudence à propos de l’exonération de la responsabilité du transporteur ferroviaire en cas de faute de la victime », note sous Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-13840 : AJCA 2020, p. 27.
-
15.
Cass. civ., 6 juill. 1925 : S. 1925, 1, p. 278.
-
16.
Cass. 1re civ., 1er déc. 2011, n° 10-19090.
-
17.
Cass. 1re civ., 12 déc. 1978, n° 77-14300 : Bull. civ. I, n° 386.
-
18.
Escarra J.-E., Hémard J. et Rault J., Traité théorique et pratique de droit commercial, t. 2, Les contrats commerciaux, 1955, Sirey, n° 1010 et s.
-
19.
V. pourtant, en ce sens, Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-12540 : Bull. civ. I, n° 269
-
20.
V. pourtant, en ce sens, Cass. 1re civ., 12 déc. 1978, n° 18-13840 : Bull. civ. I, n° 386.
-
21.
En ce sens, v. not. Aubrée Y., « La responsabilité civile du transporteur ferroviaire au cours du transport du voyageur », note sous Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-12540 : Bull. civ. I, n° 269 ; JCP 1999, II 10186.
-
22.
T. confl., 5 déc. 1983, n° 02307, Niddam c/ SNCF : Lebon, p. 541.
-
23.
V. ant. CJUE, 7 mars 2018, n° C-274/16, Flightright GmbH c/ Air Nostrum, Linéas Aéreas del Mediterraneo SA ; CJUE, 7 mars 2018, n° C-447/16, R. Becker c/ Hainan Airlaines Co. Ltd et CJUE, 7 mars 2018, n° C-448/16, M., A., Z., N., Barkan et S. Asbai c/ Air Nostrum, Linéas Aéreas del Mediterraneo SA : RDC 2019, n° 115v5, p. 89 et s., note Haftel B. ; RDC 2019, n° 115v5, p. 90 et s., note Haftel B. ; LEDC mai 2018, n° 111n4, p. 6, obs. Cattalano-Cloarec G. ; Gaz. Pal. 17 avr. 2018, n° 319y8, p. 22 et s., note Augos V. ; JCP E 2018, 1514 et s., obs. Heymann J. ; Énergie - Env. - Infrastr. 2018, comm. 36, note Ktorza R. ; RTD com. 2018, p. 518, obs. Marisse-d’Abbadie d’Arrast A. ; D. 2018, p. 1366, note Dupont P. et Poissonnier G. ; Europe 2018, comm. 213, note Idot L. ; Procédures 2018, comm. 146, note Nourissat C. ; LPA 11 déc. 2019, n° 149z1, p. 12, obs. Durand V. V. égal. Bloch L., « La CJUE et la responsabilité des transporteurs aériens : une escadrille de décisions », Resp. civ. et assur. 2018, étude 8.
-
24.
CJUE, 7 nov. 2019, n° C-213/18, Adriano Guaitoli et a. c/ EasyJet Airline Co. Ltd : JT 2020, p. 12, obs. Delpech X. ; Gaz. Pal. 7 janv. 2020, n° 367g9, p. 23, note Dupont P. et Poissonnière G. ; Bloch L., « Précisions récentes sur le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens » : Resp. civ. et assur. 2020, étude 1, n° 7 et s. ; Europe 2020, comm. 36, obs. Idot L.
-
25.
Par la suite, règl. (CE) n° 261/2004 du PE et du Cons., 11 févr. 2004.
-
26.
Par la suite, Convention de Montréal du 28 mai 1999.
-
27.
La réponse apportée à la seconde question préjudicielle rend la troisième question sans objet. Seules les deux premières questions seront donc exposées ici.
-
28.
Par la suite, CJUE.
-
29.
La question préjudicielle vise en effet le règlement (CE) n° 44/2001 du PE et du Cons. du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
-
30.
Par la suite, règl. (UE) n° 1215/2012 du PE et du Cons., 12 déc. 2012.
-
31.
Et, plus précisément art. 7, pt 1 de ce texte.
-
32.
Pt 33.
-
33.
Pt 33.
-
34.
Pt 38. La CJUE rappelle à ce titre que cette organisation résulte d’un « souci de renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’Union, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait ».
-
35.
Règl. (UE) n° 1215/2012 du PE et du Cons., 12 déc. 2012, art. 4.
-
36.
Règl. (UE) n° 1215/2012 du PE et du Cons., 12 déc. 2012, art. 7, pt 1, a). L’article 7, pt 1, b), de ce texte précise qu’« aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base la demande est : (…) pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ».
-
37.
Pt 34.
-
38.
Relatif à l’action en responsabilité en raison du retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises.
-
39.
Pt 55.
-
40.
« Annulation de vol inclus dans un forfait touristique : quel régime d’indemnisation ? », Dalloz actualité, 24 sept. 2019, obs. Delpech X. ; D. 2019, p. 1446 ; JT 2019, p. 40, obs. Lachièze C. ; JT 2020, p. 44, obs. Augros V. ; RDC déc. 2019, n° 116m6, p. 115 et s., note Heymann J. ; JCP E 2019, n° 40, p. 1440, n° 20, obs. Bon-Garcin I. ; Europe 2019, comm. 379, obs. Michel V. ; JCP G 2019, 810, obs. Berlin D. ; JCP E 2019, n° 47, p. 1521, obs. Dupont P. et Poissonnier G.
-
41.
Pt 20. En l’espèce, le transporteur aérien cesse cette prestation de transport « en raison de l’impossibilité d’obtenir le prix préalablement fixé avec Hellas ».
-
42.
L’article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 définit le champ d’application de la protection octroyée aux voyageurs victimes d’annulation et de retard important de vol.
-
43.
« Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits des passagers établis par la directive n° 90/314/CEE. Le présent règlement ne s’applique pas lorsqu’un voyage à forfait est annulé pour des raisons autres que l’annulation du vol. »
-
44.
Pt 44.
-
45.
Pt 29.
-
46.
Au sens de la directive, le forfait touristique correspond à « la combinaison préalable d’au moins deux des éléments suivants, lorsqu’elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris et lorsque cette prestation dépasse 24 heures ou inclut une nuitée : a) transport ; b) logement ; c) autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait » (art. 2, 1). V. égal. sur la notion de forfait, CJCE, 30 avr. 2002, n° C-400/00 : JT 2010, p. 44, note Teissonnière G.
-
47.
Pt 31.
-
48.
V. not. RDC déc. 2019, n° 116m6, p. 115 et s., note Heymann J.
-
49.
La CJUE rappelle ainsi que le législateur de l’Union a « entendu maintenir à leur égard les effets du système jugé suffisamment protecteur qui avait été mis en place antérieurement par la directive n° 90/314/CEE » (pt 32). Plus loin dans l’arrêt, la Cour précise également que l’interprétation retenue permet d’éviter une solution « de nature à conduire à une surprotection injustifiée du passager concerné, cela au détriment du transporteur aérien effectif, ce dernier risquant en effet, en ce cas, de devoir assumer en partie la responsabilité qui incombe à l’organisateur de voyages à l’égard de ses clients, en vertu du contrat que celui-ci a conclu avec ces derniers ».
-
50.
Pt 44.
-
51.
Pt 37.
-
52.
Dir. n° 90/314/CEE, art. 7. La fourniture d’une garantie financière est inscrite à l’article L. 211-18, 1° du Code du tourisme en tant que condition d’obtention de l’immatriculation permettant à un opérateur de réaliser les activités touristiques au nombre desquelles la vente de forfait touristique. V. égal. C. tourisme, art. R. 211-26 à C. tourisme, art. R. 211-34.
-
53.
Pt 41.
-
54.
V. not. JT 2020, p. 44, obs. Augros V.
-
55.
Pt 42.