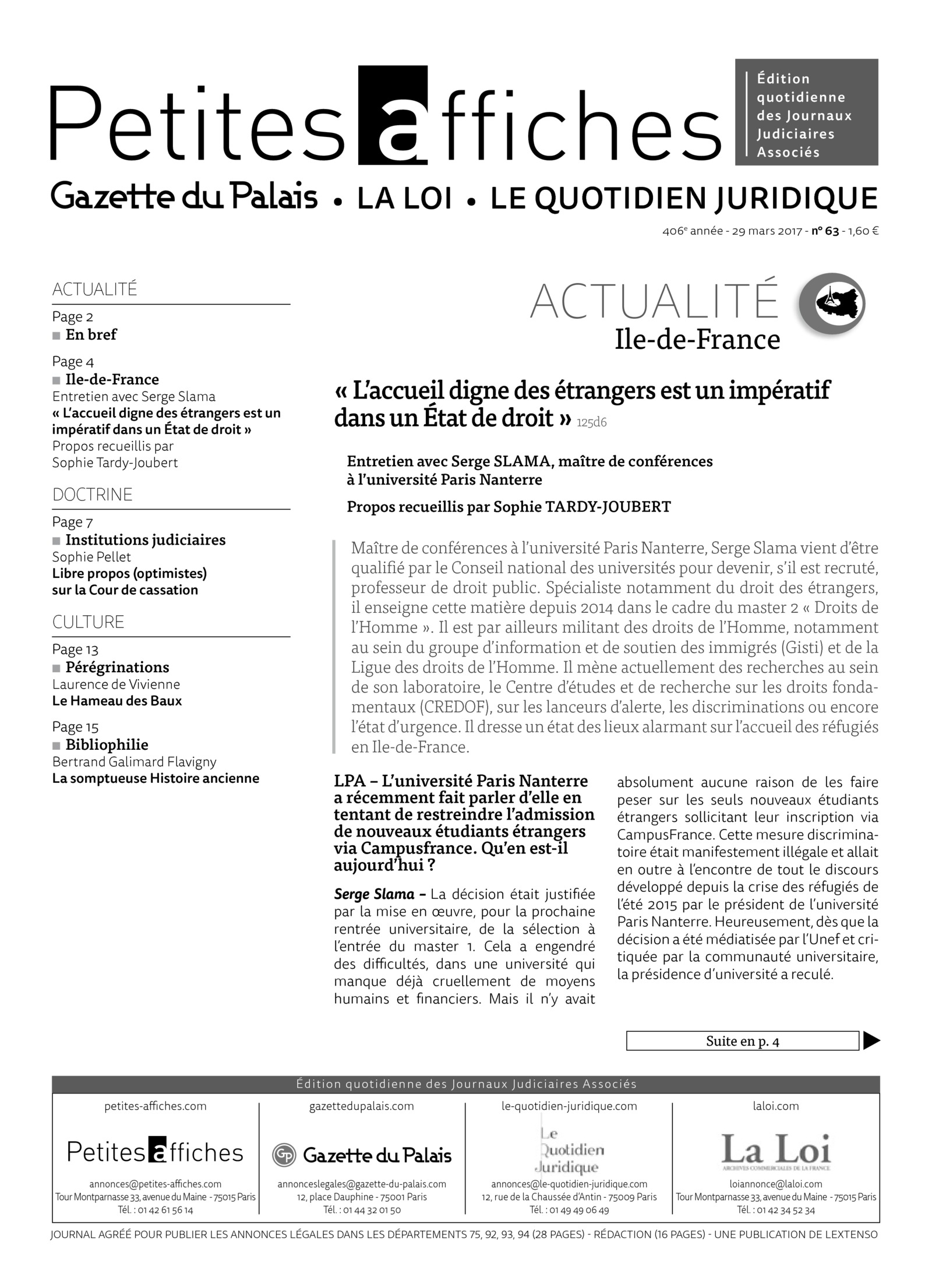« L’accueil digne des étrangers est un impératif dans un État de droit »
Maître de conférences à l’université Paris Nanterre, Serge Slama vient d’être qualifié par le Conseil national des universités pour devenir, s’il est recruté, professeur de droit public. Spécialiste notamment du droit des étrangers, il enseigne cette matière depuis 2014 dans le cadre du master 2 « Droits de l’Homme ». Il est par ailleurs militant des droits de l’Homme, notamment au sein du groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti) et de la Ligue des droits de l’Homme. Il mène actuellement des recherches au sein de son laboratoire, le Centre d’études et de recherche sur les droits fondamentaux (CREDOF), sur les lanceurs d’alerte, les discriminations ou encore l’état d’urgence. Il dresse un état des lieux alarmant sur l’accueil des réfugiés en Ile-de-France.
LPA – L’université Paris Nanterre a récemment fait parler d’elle en tentant de restreindre l’admission de nouveaux étudiants étrangers via Campusfrance. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Serge Slama – La décision était justifiée par la mise en œuvre, pour la prochaine rentrée universitaire, de la sélection à l’entrée du master 1. Cela a engendré des difficultés, dans une université qui manque déjà cruellement de moyens humains et financiers. Mais il n’y avait absolument aucune raison de les faire peser sur les seuls nouveaux étudiants étrangers sollicitant leur inscription via CampusFrance. Cette mesure discriminatoire était manifestement illégale et allait en outre à l’encontre de tout le discours développé depuis la crise des réfugiés de l’été 2015 par le président de l’université Paris Nanterre. Heureusement, dès que la décision a été médiatisée par l’Unef et critiquée par la communauté universitaire, la présidence d’université a reculé.
LPA – De manière générale, accueille-t-on suffisamment d’étudiants étrangers en France ?
S. S. – La France a fait des progrès ces dernières années en la matière. 70 000 nouveaux étudiants non-européens ont été accueillis en 2016. La France est le troisième pays d’accueil, derrière les États-Unis et la Grande-Bretagne, avec près de 300 000 étudiants étrangers, soit 12,1 % des effectifs de l’enseignement supérieur. Le statut a évolué favorablement ces dernières années. Après la mobilisation autour de la circulaire du 31 mai 2011 dite Guéant, le gouvernement issu des élections de 2012 a amélioré les possibilités de changement de statut et la loi du 7 mars 2016 a généralisé les cartes de séjour pluriannuelles ou encore les visas long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) qui permettent à l’étranger de séjourner en France la première année sans titre de séjour.
Les universités manquent néanmoins de dispositifs d’accueil permettant aux étudiants étrangers de s’acclimater au système français. Quand on regarde la qualité des programmes d’accueil des étudiants étrangers aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, mais aussi en Allemagne ou aux Pays-Bas, la France est loin des standards internationaux d’accueil des étudiants étrangers et les procédures administratives restent lourdes. Aux États-Unis, les universités accueillent parfois, dans certaines filières, jusqu’à 50 % d’étudiants étrangers.
LPA – Qu’en est-il de l’accueil des réfugiés en Ile-de-France ?
S. S. – La réforme du droit d’asile adoptée en juillet 2015, et entrée en vigueur en novembre 2015, était censée assurer une meilleure prise en charge des demandeurs d’asile. Dans la pratique, le dispositif reste totalement engorgé, particulièrement sur Paris. Il faut attendre jusqu’à 4 mois pour que les plates-formes d’accueil des demandeurs d’asile, gérées par des associations comme France terre d’asile, délivrent des rendez-vous en préfecture. Or ce n’est qu’à partir de l’enregistrement de sa demande d’asile avec la délivrance de l’attestation de maintien sur le territoire que les droits sociaux des demandeurs d’asile sont ouverts : admission en centre d’accueil pour demandeurs d’asile et droit à l’allocation pour demandeurs d’asile, de 6,80 € par jour pour une personne. Malgré la création de nouvelles places en centres d’accueil, le dispositif reste sous-dimensionné : environ 45 000 places pour 100 000 demandeurs d’asile en 2016. L’engorgement du dispositif parisien est particulièrement inquiétant et cela explique la multiplication des campements de migrants, surtout après le démantèlement du bidonville de Calais et en raison des pratiques policières visant à empêcher les exilés d’y retourner.
LPA – La mairie de Paris a pourtant ouvert un centre humanitaire de 400 places en novembre dernier…
S. S. – Ce n’est pas le centre humanitaire lui-même qui est problématique. Géré par Emmaüs, il est plutôt bien conçu. Mais ce centre ne peut être qu’un pis-aller tant que l’État ne joue pas le jeu et n’assure pas en aval suffisamment de places dans les centres d’accueil et d’orientation (CAO) et surtout dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile. Ce centre n’est qu’un sas d’entrée dans le dispositif d’asile mais celui-ci souffre d’une saturation importante, compte tenu de son dimensionnement structurel qui a été organisé entre 2003 et 2013 afin de le rendre dissuasif. On est pourtant, proportionnellement au nombre d’habitants, loin des taux d’accueil de l’Allemagne, la Suède, la Belgique, la Grèce ou même la Hongrie. Par ailleurs, le taux de reconnaissance d’une protection internationale reste en France en deçà des taux d’autres pays comme l’Allemagne ou la Suède et le sort des déboutés du droit d’asile (50 000 par an) est problématique.
LPA – Quelle solution préconisez-vous ?
S. S. – Il aurait fallu penser une répartition à l’échelle de l’Union européenne. Il n’aurait pas fallu conclure l’accord signé avec la Turquie le 18 mars 2016- qui visait à couper la route des Balkans vers l’Allemagne. Encore aujourd’hui, une dizaine de milliers de personnes sont retenues à Lesbos dans les hotspots qui ont été transformés en centres de rétention à la suite de cet accord.
Au moment de la guerre du Kosovo (2001), l’Union européenne avait adopté, à la demande de l’Allemagne, une directive « protection temporaire » pour répartir les demandeurs d’asile entre les pays membres. C’est vers ce genre de solutions que nous aurions dû aller. Seulement, il aurait fallu que tous les pays jouent le jeu, or tel est loin d’être le cas. De nombreux pays européens n’accueillent presque pas de demandeurs d’asile alors que l’Allemagne en a accueilli près d’un million en 2015/2016, dont une grande majorité des réfugiés arrivant de Syrie.
LPA – La France se met-elle hors la loi ?
S. S. – L’accueil des demandeurs d’asile est une obligation issue des directives européennes et inscrite dans la loi française et confirmée à de nombreuses reprises par la jurisprudence française et européenne. La France est liée par les conventions de Genève de 1951, ainsi que par plusieurs directives européennes de 2013. La demande d’asile doit être enregistrée dans les trois jours et les demandeurs d’asile, qui n’ont pas le droit de travailler, doivent être pris en charge par l’État durant l’examen de leur demande d’asile. Aujourd’hui, à Paris, le délai pour obtenir une autorisation de maintien sur le territoire est de quatre mois au lieu de trois jours. La France s’est par ailleurs engagée en septembre 2015 à accueillir 30 000 réfugiés en besoin manifeste de protection, en premier lieu des Syriens et des Érythréens. Pour le moment nous n’en avons accueilli que 3 000, malgré les efforts réels des autorités françaises (OFII, OFPRA). On pourrait imaginer un recours devant le Conseil d’État pour que la France respecte cette obligation…
LPA – Quelle est la situation des mineurs isolés ?
S. S. – Le nombre de mineurs isolés a augmenté ces dernières années, mais on ne sait pas exactement combien ils sont aujourd’hui. Ils étaient 8 000 en 2013, dont une grande partie recensée en Ile-de-France, particulièrement en Seine-Saint-Denis. Pendant longtemps, il n’y avait aucun dispositif national : ces mineurs relèvent de l’aide sociale à l’enfance, et donc, du département. Désormais, dans le prolongement de la circulaire Taubira qui avait été partiellement censurée par le Conseil d’État en janvier 2015, la loi du 14 mars 2016 et un décret du 24 juin 2016 mettent en œuvre une clé de répartition à l’échelle nationale. Le problème, c’est que tous les départements ne jouent pas le jeu.
LPA – Comment se déroule la procédure ?
S. S. – Lorsqu’un mineur non accompagné se présente, il doit d’abord bénéficier d’une mise à l’abri et il fait l’objet d’une évaluation médico-sociale afin d’évaluer s’il est vraiment isolé et mineur.
Le mineur fait ensuite l’objet d’une ordonnance provisoire de placement du parquet des mineurs. Mais s’il est considéré majeur, éventuellement après recours à des examens médico-sociaux, y compris un test osseux, légalisé par la loi du 14 mars 2016 alors même qu’ils sont scientifiquement contestés, il est remis à la rue. Il peut alors se retourner vers le juge des enfants en le saisissant directement sur le fondement de l’article 375 du Code civil. Ce n’est que dans le cas où une ordonnance de placement du juge des enfants n’a pas été respectée qu’il est possible pour le mineur, en raison de circonstances particulières, de saisir le tribunal administratif en référé-liberté, sans représentant légal, pour obtenir son hébergement d’urgence. Cette situation n’est pas satisfaisante. Même si ces jeunes sont réellement majeurs, ils n’en sont pas moins vulnérables, surtout s’il s’agit de jeunes femmes. De manière globale, le système français reste insuffisamment protecteur et les possibilités de saisine des juges, particulièrement du juge administratif des référés, ne sont pas en conformité avec les exigences de l’article 13 de la Convention EDH combiné à son article 3.
LPA – A-t-on le droit d’héberger un migrant sans-papiers chez soi, comme le font désormais certains Parisiens ?
S. S. – Tout dépend de son statut précis et du motif de l’hébergement. S’il s’agit d’un mineur isolé ou d’un demandeur d’asile, il n’y a aucun risque. En revanche si on héberge un sans-papiers par pure humanité, même sans aucune contrepartie, on tombe sous le coup du délit d’aide au séjour irrégulier sur le territoire français, que l’on appelle, en langage associatif, le « délit de solidarité ». Il existe en France depuis 1938 et a été aggravé dans les années 1980. L’article L. 622-1 du CESEDA prévoit en effet que « toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 € ». Dans les années 1990, suite au premier mouvement des « délinquants de la solidarité » (collectif des cinéastes, affaire Deltombe), des exonérations existent au bénéfice des ascendants ou descendants de l’étranger ou de son conjoint. D’autre part, depuis une polémique entre Éric Besson, alors ministre de l’Immigration et de l’Identité nationale, et le mouvement associatif, la loi Valls de 2012 protège les personnes physiques ou morales « lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci ».
LPA – Ces exonérations ne sont-elles pas suffisantes ?
S. S. – Non, car le problème reste entier si l’on aide de manière désintéressée un sans-papiers uniquement par humanité ou par solidarité ou simplement parce qu’on ne conçoit pas de demander à un être humain son statut administratif pour lui venir en aide. On risque toujours des poursuites et une condamnation. Pour que l’humanité ne soit plus un délit, la meilleure solution serait donc d’abroger l’article L. 622-1 ou, à tout le moins, d’ajouter dans la définition de ce délit qu’il n’est pas constitué s’il n’a pas donné lieu à une contrepartie.