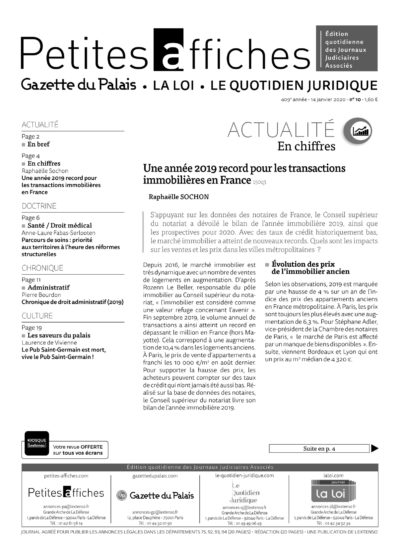Chronique de droit administratif (2019)
La présente chronique rend compte de quelques décisions récentes, concernant l’administration locale et les contrats administratifs, rendues par les juridictions administratives et par la Cour de justice de l’Union européenne.
I – Administration locale
A – Confirmation en appel : le principe de laïcité ne fait pas obstacle aux « menus de substitution » (CAA Lyon, 23 oct. 2018, nos 17LY03323 et 17LY03328, Cne de Chalon-sur-Saône)
Un jugement Ligue de défense judiciaire des musulmans rendu par le tribunal administratif de Dijon le 28 août 2017 sur les « menus de substitution » a été commenté dans une chronique publiée dans cette revue1. Le tribunal administratif avait annulé une délibération du 29 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Chalon-sur-Saône avait approuvé le règlement des cantines scolaires supprimant des « menus de substitution ». Comme annoncé, la commune avait interjeté appel. Par un arrêt du 23 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Lyon, en formation de chambres réunies (signe de solennité), a annulé le jugement du tribunal administratif, tout en maintenant l’annulation de la délibération de la commune.
Dans un premier temps, la cour administrative d’appel a annulé le jugement du tribunal administratif en estimant qu’un moyen qui n’était pas d’ordre public tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE, dite convention de New York dans l’arrêt ici commenté) avait été relevé d’office. Le tribunal avait estimé que ce moyen relatif à l’intérêt supérieur des enfants était implicitement invoqué « par le dernier mémoire des requérants »2.
Dans ses conclusions sur ce jugement, le rapporteur public Thierry Bataillard (que nous remercions pour la communication de ses conclusions) avait précisé en ce sens que « les requérants invoquent un certain nombre d’arguments concernant les véritables usagers de ce service public qui sont les enfants. Ils observent que l’équilibre nutritionnel des repas serait atteint avec la disparition de la viande et que les enfants originaires de familles modestes n’ont souvent pas d’autre choix pour leur restauration que de fréquenter le service public de la cantine scolaire. Vous pourrez en déduire qu’ils doivent être regardés comme ayant invoqué la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants fréquentant les cantines scolaires ».
La cour a remis en cause cette appréciation des premiers juges en observant que le moyen n’avait été invoqué, ni « explicitement », ni implicitement faute d’« argumentation susceptible d’être rattachée à un tel moyen »3. Cette remise en cause est stricte. Certes, la jurisprudence administrative refuse depuis 1991 le caractère d’ordre public au moyen d’inconventionnalité4. Mais cette position du Conseil d’État (qui peut être discutée) n’est pas celle de la Cour de cassation5. Elle n’a pas non plus été celle de la cour administrative d’appel de Paris à une occasion6. Ces circonstances pouvaient appeler un peu de souplesse de la part de la cour administrative d’appel de Lyon.
L’annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon ne change toutefois rien à l’affaire. Qui sait si la cour administrative d’appel n’a pas souhaité annuler le jugement du tribunal pour mieux inscrire cette affaire dans le marbre de sa propre jurisprudence ?
Car, dans un second temps, la cour administrative d’appel a maintenu l’annulation de la délibération par laquelle la commune de Chalon a voulu supprimer des « menus de substitution » (dits « menus alternatifs » dans l’arrêt). La cour a presque repris les mêmes motifs que ceux développés par le tribunal, tout en ôtant les passages litigieux relatifs à la CIDE et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Les points 9 à 12 du jugement annulé ont été pour l’essentiel ramassés dans un point 13 de l’arrêt rédigé en ces termes : « Il est constant que, depuis 1984, les restaurants scolaires des écoles publiques de Chalon-sur-Saône proposaient à leurs usagers des menus alternatifs leur permettant de bénéficier de repas répondant aux bonnes pratiques nutritionnelles sans être contraints de consommer des aliments prohibés par leurs convictions religieuses. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pendant les 31 années qu’elle a duré, cette pratique aurait provoqué des troubles à l’ordre public ou été à l’origine de difficultés particulières en ce qui concerne l’organisation et la gestion du service public de la restauration scolaire. Il suit de là qu’en se fondant exclusivement sur les principes de laïcité et de neutralité du service public pour décider de mettre un terme à une telle pratique, le maire de Chalon-sur-Saône et le conseil municipal de Chalon-sur-Saône ont entaché leur décision et délibération attaquées d’erreur de droit ».
Finalement, l’arrêt du 23 octobre 2018 remet en cause le jugement du tribunal dans certains de ses motifs apparents. Mais les principes sous-jacents du jugement annulé ne sont pas remis en cause. Ni les conclusions du rapporteur public Samuel Deliancourt (que nous remercions pour leur transmission), ni l’arrêt ne disent que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant était inopérant. L’on peut aussi rappeler que le principe d’espérance légitime et le principe de tolérance n’étaient pas non plus, de notre point de vue, inopérants7. À ce sujet, le point 12 de l’arrêt de la cour est empreint de la même tolérance que celle du point 10 du jugement annulé.
On peut rappeler que le tribunal administratif avait estimé au point 10 de son jugement « que si une contrainte technique ou financière peut légalement motiver, dans le cadre du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, une adaptation des modalités du service public de la restauration scolaire, il ressort du rapport préalable devant le conseil municipal, du compte rendu de la séance du conseil municipal, de la motivation des décisions attaquées et de la défense que ces décisions ont procédé non pas d’une telle contrainte mais d’une position de principe se référant à une conception du principe de laïcité ».
Respectant la même tolérance, la cour administrative d’appel a estimé au point 12 de son arrêt : « Les principes de laïcité et de neutralité auxquels est soumis le service public ne font, par eux-mêmes, pas obstacle à ce que, en l’absence de nécessité se rapportant à son organisation ou son fonctionnement, les usagers du service public facultatif de la restauration scolaire se voient offrir un choix leur permettant de bénéficier d’un menu équilibré sans avoir à consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses ou philosophiques ».
Un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel a été déposé en décembre 2018 et admis par le Conseil d’État en février 2019… il devrait être tranché dans les mois à venir. Encore une affaire à suivre !
B – Un maire ne peut pas empêcher le déploiement des compteurs Linky (CE, 11 juill. 2019, n° 426060, Cne de Cast : Lebon T., à paraître)
Les évolutions techniques ou technologiques font souvent l’objet de litiges soumis au juge administratif. Bien longtemps avant les antennes-relais ou les éoliennes, l’on se souvient de la décision Vannier sur les antennes-TV par laquelle le Conseil d’État a implicitement consacré le principe de mutabilité du service public8. Le contentieux des compteurs Linky s’inscrit dans cette suite jurisprudentielle sur les évolutions techniques et technologiques. La série de décisions rendues par le Conseil d’État au cours de l’été 2019 à propos de ces compteurs ne remet pas en cause la protection ancienne du Conseil vis-à-vis de la mutabilité du service public.
Le compteur de consommation d’électricité communicant, que l’on appelle couramment « compteur Linky », fait l’objet d’une défiance. L’émission d’ondes électromagnétiques par ces compteurs serait la cause de troubles dont témoignent certains usagers. Pour bien comprendre l’enjeu de cette critique, il convient de souligner que les ondes électromagnétiques ne sont pas seulement artificielles, puisqu’elles sont aussi produites naturellement, notamment par la foudre, le soleil, et même les humains et les animaux.
Dans une décision Commune de Cast rendue le 11 juillet 2019, le Conseil d’État a annulé l’arrêté par lequel le maire d’une commune du département du Finistère a suspendu l’installation des compteurs Linky dans sa commune. L’approche du Conseil d’État dans cette affaire est similaire à celle observée dans d’autres contentieux techniques ou technologiques.
Dans les affaires concernant les antennes-relais9, les éoliennes10 ou les OGM11, le Conseil d’État a estimé que le législateur avait confié aux services de l’État la mission de veiller au bon fonctionnement de ces dispositifs techniques ou technologiques. Corollairement, le Conseil a estimé qu’aucune autre autorité, telle qu’un maire, n’est compétente pour prendre des mesures réglementaires à ce sujet.
Mutatis mutandis, le Conseil d’État a estimé dans l’affaire des compteurs Linky que le législateur avait confié aux services de l’État le soin de veiller au bon fonctionnement des dispositifs de comptage de la consommation d’électricité, y compris en ce qui concerne leur impact sanitaire. Il en a été déduit que le maire n’était pas compétent pour prendre un arrêté de suspension dans le cadre de ses pouvoirs généraux de police administrative.
Néanmoins, certains individus sont plus sensibles que d’autres aux ondes électromagnétiques et des mesures individuelles doivent être prises à leur égard (installation d’un dispositif de filtre protégeant des champs électromagnétiques), comme l’a ordonné le 23 avril 2019 le juge des référés du TGI de Bordeaux pour 13 des 206 personnes qui s’opposaient à l’installation de compteurs Linky. À défaut d’être compétents pour prendre des mesures générales de suspension, les maires ne pourraient-ils pas arrêter des mesures individuelles en faveur des individus dont la sensibilité est dûment constatée ?
II – Contrats administratifs
A – Candidature d’une personne publique à un appel d’offres : l’intérêt public local s’apprécie souplement, ici comme ailleurs (CE, 14 juin 2019, n° 411444, Sté Armor SNC : Lebon T., à paraître)
La décision rendue par le Conseil d’État le 14 juin 2019 concernant la société Armor SNC n’est pas la première dans ce litige qui oppose cette société aux deux départements de la Charente-Maritime et de la Vendée.
En 2006, le département de la Vendée a lancé une procédure d’appel d’offres portant sur le dragage d’un estuaire, le Lay. Le département de la Charente-Maritime assure déjà ce service pour son propre compte avec sa propre drague. Son bateau, dénommé « Fort Boyard », a été acheté en 2002 pour la somme de 5,5 millions d’euros et affecté à une régie dénommée « service départemental des dragages ». Souhaitant rentabiliser son investissement, le département de la Charente-Maritime a déposé une offre auprès du département voisin et s’est vu attribuer le marché. La société Armor SNC, concurrente évincée, a saisi le tribunal administratif de Nantes, puis la cour administrative d’appel de Nantes, qui ont tour à tour statué en faveur du département de la Charente-Maritime.
Le Conseil d’État a été saisi une première fois en cassation. Dans une décision du 30 décembre 2014, le Conseil a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel au motif que le juge d’appel avait estimé que le département de la Charente-Maritime n’était pas tenu de justifier d’un intérêt public départemental pour candidater à un appel d’offres en dehors de son territoire. L’affaire avait été renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes12.
Dans sa décision du 30 décembre 2014, le Conseil d’État a énoncé le principe suivant : « Hormis celles qui leur sont confiées pour le compte de l’État, les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération s’exercent en vue de satisfaire un intérêt public local. Si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou leurs établissements publics de coopération se portent candidats à l’attribution d’un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle répond à un tel intérêt public, c’est-à-dire si elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou l’établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de la mission ».
Saisie une seconde fois en appel, la cour administrative d’appel de Nantes avait de nouveau rejeté la requête de la société Armor SNC. Faisant application du principe énoncé par le Conseil d’État dans sa décision du 30 décembre 2014, le juge d’appel avait estimé « qu’il ressort des pièces du dossier que la drague “Fort Boyard”, acquise en mai 2002 au prix de 5 529 519,29 € sur le budget principal du département de la Charente-Maritime, a été en partie financée par une subvention d’investissement de 1 322 215,76 € ; qu’elle a été transférée au budget annexe du “service départemental des dragages” par décision modificative du conseil général de la Charente-Maritime suivant délibération du 6 juillet 2007 en vue d’une régularisation budgétaire et comptable ; qu’alors que cet engin présente une durée d’amortissement affichée de 30 ans, il ne résulte pas des données comptables fournies en défense que la drague “Fort Boyard” ait été intégralement amortie sur la période prévue pour la durée du contrat y compris celle correspondant à sa reconduction ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le département de la Charente-Maritime pouvait se porter candidat à l’attribution du marché de réalisation de travaux de dragage de l’estuaire du Lay pour le compte du département de la Vendée pour une durée d’un an, avec possibilité de reconduction pendant trois années, afin notamment d’amortir les coûts d’investissement et de fonctionnement de son équipement, dont l’utilisation au profit d’une autre collectivité publique dans le cadre du marché public attribué constituait ainsi un prolongement de son propre service public et revêtait dès lors un intérêt public départemental ».
Ce faisant, la cour administrative d’appel avait retenu une appréciation assez classique en matière d’amortissement des biens utiles à la gestion d’un service public. La durée d’une concession de service se calcule, en principe, au regard de la durée d’amortissement des biens13. Et l’on sait « que lorsque la durée du contrat est inférieure à la durée normale d’amortissement de l’ouvrage, le cocontractant a le droit d’être indemnisé de la valeur non amortie de cet ouvrage au terme du contrat, et donc à hauteur de sa valeur nette comptable, évaluée à la date de la remise des biens »14. L’indemnisation de la valeur nette comptable peut même être versée dès le début de l’exécution du contrat15. En cas d’annulation de la concession, l’indemnisation des dépenses utiles du concessionnaire est également calculée au regard de la valeur nette comptable des biens16.
Cependant, le Conseil d’État, saisi d’un second pourvoi en cassation, a de nouveau annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel par sa décision du 14 juin 2019 ici commentée. Après avoir apporté des précisions au principe énoncé dans sa décision du 30 décembre 2014, le Conseil a estimé que la notion d’intérêt public local devait faire l’objet d’une appréciation plus souple que celle retenue par la cour : « La candidature d’une collectivité territoriale à l’attribution d’un contrat de commande publique peut être regardée comme répondant à un intérêt public local lorsqu’elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité a la charge, notamment parce que l’attribution du contrat permettrait d’amortir des équipements dont elle dispose. Cet amortissement ne doit toutefois pas s’entendre dans un sens précisément comptable, mais plus largement comme traduisant l’intérêt qui s’attache à l’augmentation du taux d’utilisation des équipements de la collectivité, dès lors que ces derniers ne sont pas surdimensionnés par rapport à ses propres besoins. Par suite, en se bornant à prendre en compte la durée d’amortissement comptable de la drague “Fort Boyard” pour apprécier l’intérêt public local de la candidature du département de la Charente-Maritime, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit ».
Cette décision du 14 juin 2019 n’a pas vraiment de quoi surprendre. L’appréciation de l’intérêt public local est classiquement assez souple. Au titre du prolongement d’une mission de service public, le Conseil d’État a par exemple déjà admis :
-
la vente d’appareils de chauffage par le service public du gaz17 ;
-
les désinfections réalisées à titre onéreux par un service de désinfection vétérinaire18 ;
-
la vente de fournitures funéraires par un service des pompes funèbres19 ;
-
une station-service dans un parking public20 ;
-
un service de réhabilitation des installations d’assainissement par le service d’assainissement non collectif21.
Attention, toutefois, cela ne signifie pas que la condition de l’intérêt public local soit toujours considérée comme remplie22.
B – Le recours en contestation de légalité du contrat est ouvert aux cocontractants pendant toute la durée d’exécution du contrat (CE, sect., 1er juill. 2019, n° 412243, Ass. pour le musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon : Lebon, à paraître)
La décision Commune de Béziers rendue par le Conseil d’État à la fin de l’année 2009 a réorganisé l’action qui permet aux parties au contrat administratif de critiquer la légalité du contrat23. Désormais, les cocontractants peuvent demander au juge l’annulation (ou nullité), mais aussi la résiliation, la modification ou une indemnisation en cas d’irrégularité du contrat. Une des nombreuses questions posées à la suite de cette décision était de savoir ce qu’il adviendrait de la prescription de la nullité24. Question d’autant plus importante que l’année précédant la décision Commune de Béziers, la prescription en matière civile a été réformée25.
Jusqu’en 2008, l’article 2262 du Code civil disposait que « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par 30 ans ». Le Conseil d’État avait fait application de ce délai à propos de l’action en nullité d’une partie au contrat administratif26. Le même délai était appliqué aux créances contractuelles27, ainsi qu’aux créances extracontractuelles28. Avec la réforme de 2008, l’article 2262 du Code civil, devenu l’article 2224, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans ». Dans ces conditions, la prescription de l’action en nullité du contrat administratif ne pouvait certainement pas demeurer en l’état de son délai de trente ans.
En 2009, la décision Commune de Béziers n’a pas abordé la question de la prescription du nouveau recours ouvert aux parties au contrat. Fallait-il y voir l’absence de tout délai de prescription ? En comparaison, la décision Société Tropic rendue deux ans plus tôt indiquait quant à elle que le nouveau recours ouvert aux concurrents évincés « doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées »29. La décision Département de Tarn-et-Garonne rendue en 2014 avait repris les mêmes termes30.
En première instance, puis en appel, le juge de l’affaire Association pour le musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon avait estimé que la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil s’appliquait au recours issu de la décision Commune de Béziers. Censurant l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux, le Conseil d’État a confirmé l’absence de tout délai de prescription à l’égard de l’action ouverte aux cocontractants pour critiquer la légalité du contrat. Ni 30 ans, ni 5 ans. Aucun délai. Pas même un « délai raisonnable » d’un an comme l’a prévu la jurisprudence issue de la décision Czabaj à l’égard des décisions individuelles dont la notification ne mentionne pas les voies et délais de recours31.
Il faut dire aussi que le juge du contrat administratif illégal dispose déjà d’outils plus efficaces et légitimes que la prescription pour faire obstacle à un recours tardif. La loyauté des relations contractuelles peut tout à fait être opposée au cocontractant qui aurait tardé à exercer une action contre le contrat. Les parties au contrat ne doivent donc pas penser qu’elles disposent d’un délai de recours illimité contre le contrat qu’elles suspectent d’illégalité. Malgré l’absence de tout délai de prescription, le temps peut être pris en compte par le juge du contrat administratif illégal au moment d’apprécier le bien-fondé de l’argumentation du requérant qui critique la légalité du contrat.
C – Le recours d’un tiers contre la décision d’attribution d’un marché public ne doit pas être impossible ou excessivement difficile (CJUE, 5 sept. 2019, n° C-333/18, Lombardi Srl contre Comune di Auletta)
La décision Lombardi Srl dans laquelle la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé l’importance du droit à un recours effectif concernait une question préjudicielle posée par le Conseil d’État italien dans un litige concernant l’attribution d’un marché public. En l’occurrence, la commune d’Auletta (dans la province de Salerne) avait lancé une procédure d’appel offres en vue de l’attribution d’un marché public de travaux d’assainissement de son centre historique communal. Un concurrent classé en troisième position à l’issue de la procédure, la société Lombardi, avait saisi le tribunal administratif régional de Campanie d’un recours dirigé contre les classements de l’attributaire du marché et du concurrent en deuxième position. L’attributaire, la société Delta Lavori, en avait fait de même contre le classement de la société Lombardi en troisième position.
En première instance, le tribunal administratif de Campanie avait estimé que le recours de l’attributaire était fondé et qu’en conséquence le recours de la société Lombardi devait être rejeté comme étant irrecevable pour absence d’intérêt à agir.
Saisie en appel par la société Lombardi, l’assemblée plénière du Conseil d’État italien a estimé que le tribunal administratif de Campanie aurait dû examiner les deux recours pour éventuellement déclasser l’attributaire et l’évincé. Pour être certain de cette appréciation, le juge administratif italien a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle.
Dans sa décision Lombardi Srl, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que le droit de l’Union « s’oppose à ce qu’un recours principal introduit par un soumissionnaire ayant un intérêt à obtenir un marché déterminé (…) et visant à l’exclusion d’un autre soumissionnaire soit déclaré irrecevable en application des règles ou des pratiques jurisprudentielles procédurales nationales, qui portent sur le traitement des recours en exclusion réciproques ».
L’intérêt de cette décision réside aussi dans le passage où, s’agissant « des règles ou des pratiques jurisprudentielles procédurales nationales », le juge européen affirme que « s’agissant (…) du principe d’autonomie procédurale des États membres, il suffit de rappeler que ce principe ne saurait, en tout état de cause, justifier des dispositions de droit interne qui rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union ».
L’on sait que le droit au recours des concurrents évincés d’un appel d’offres, sans être devenu impossible en France, est souvent considéré comme excessivement difficile, « en trompe-l’œil »32, depuis la jurisprudence issue des décisions SMIRGEOMES et Département de Tarn-et-Garonne. La récente décision Lombardi Srl de la Cour de justice pourrait cependant pousser le juge français à améliorer l’effectivité du droit au recours des concurrents évincés et, plus généralement, celui des tiers au contrat.
Notes de bas de pages
-
1.
LPA 16 juill. 2018, n° 136a5, p. 20-21.
-
2.
Pt 4 du jugement
-
3.
Pt 6 de l’arrêt
-
4.
CE, sect., 11 janv. 1991, n° 90995, SA Morgane : Lebon, p. 9 – CE, ass., 6 déc. 2002, n° 239540, Maciolak : Lebon, p. 426.
-
5.
Cass. ass. plén., 24 nov. 1989, n° 89-84439.
-
6.
CAA Paris, 1er juin 2005, n° 00PA03825, M. Julien.
-
7.
LPA 16 juill. 2018, n° 136a5, p. 21.
-
8.
CE, sect., 27 janv. 1961, n° 13876, Vannier : Lebon, p. 60.
-
9.
CE, ass., 26 oct. 2011, n° 326492, Cne de Saint-Denis : Lebon, p. 529.
-
10.
Cf. pro CE, 22 oct. 2018, n° 406746, Sté Ferme éolienne du Saint-Quentinois : Lebon T., p. 593.
-
11.
CE, 24 sept. 2012, n° 342990, Cne de Valence : Lebon, p. 335.
-
12.
CE, ass., 30 déc. 2014, n° 355563, Sté Armor SNC : Lebon, p. 433.
-
13.
CCP, art. R. 3114-2.
-
14.
CE, 4 juill. 2012, n° 352417, Communauté d’agglomération de Chartres Métropole (CACM) : Lebon T., p. 842.
-
15.
CE, 13 févr. 2015, n° 373645, Cté d’agglomération d’Épinal.
-
16.
CAA Bordeaux, 1er avr. 2008, n° 05BX00387, Sté auxiliaire de parcs SA c/ Cne de Brive.
-
17.
CE, sect., 29 mai 1936, n° 38964, Syndicat des entrepreneurs de couverture c/ Ville de Bordeaux : Lebon, p. 622.
-
18.
CE, 26 oct. 1979, n° 11106, Porentru : Lebon T., p. 609.
-
19.
CE, 4 juin 1954, n° 15775, Berthod : Lebon, p. 335.
-
20.
CE, sect., 18 déc. 1959, n° 22536, Delansorme : Lebon, p. 692.
-
21.
CE, 23 mai 2003, n° 249995, Cté de communes Artois-Lys : Lebon, p. 234.
-
22.
Cf. par ex. CAA Nantes, 29 mars 2000, n° 97NT00451, Centre hospitalier de Morlaix : Lebon T., p. 1095.
-
23.
CE, ass., 28 déc. 2009, n° 304802, Cne de Béziers : Lebon, p. 509.
-
24.
V. pro Grau R. et Rojano C., « Le contentieux contractuel en matière de contrats publics », RFL 2011, n° 4, p. 267.
-
25.
L. n° 2008-561, 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile.
-
26.
CE, sect., 9 juill. 1937, n° 40717, Cne d’Arzon : Lebon, p. 680.
-
27.
CE, sect., 24 mai 1974, n° 85939, Sté Paul Millet : Lebon, p. 310.
-
28.
CE, ass., 28 mai 1976, n° 88803, Centre technique des conserves de produits agricoles : Lebon, p. 282 – CE, 22 févr. 2006, n° 258555, Poplu : Lebon T., p. 708.
-
29.
CE, ass., 16 juill. 2007, n° 291545, Sté Tropic Travaux Signalisation : Lebon, p. 360.
-
30.
CE, ass., 4 avr. 2014, n° 358994, Dpt de Tarn-et-Garonne : Lebon, p. 70.
-
31.
CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763, Czabaj : Lebon, p. 340.
-
32.
Jury F., « Les droits des tiers dans le contentieux des contrats administratifs : un droit au juge en “trompe-l’œil” », RFDA 2019, p. 55.