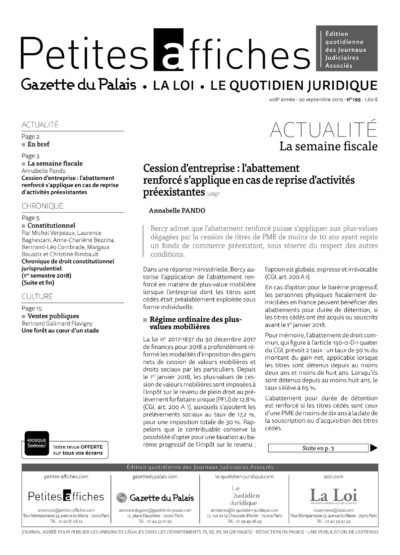Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (1er semestre 2018) (Suite et fin)
La chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel est ouverte à l’ensemble des décisions susceptibles d’intéresser le droit constitutionnel dans sa dimension contentieuse considérée de la manière la plus large. C’est ainsi que le contentieux électoral est intégré dans la présente chronique qui est divisée en quatre parties correspondant aux thèmes principaux du droit constitutionnel contemporain qui intègre aussi bien les questions institutionnelles que les problèmes de hiérarchie des normes et la place des droits et libertés.
La chronique présentée ci-dessous couvre le premier semestre de l’année 2018.
Au cours de ce semestre, le Conseil a eu l’occasion de rendre une décision, n° 2017-681 R QPC du 16 février 2018, Sté Norbail-Immobilier, relative à une rectification d’erreur matérielle. La rectification d’erreur matérielle des décisions du Conseil est régie par l’article 13 du règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité : « Si le Conseil constitutionnel constate qu’une de ses décisions est entachée d’une erreur matérielle, il peut la rectifier d’office, après avoir provoqué les explications des parties et des autorités mentionnées à l’article 1er. Les parties et les autorités mentionnées à l’article 1er peuvent, dans les 20 jours de la publication de la décision au Journal officiel, saisir le Conseil constitutionnel d’une demande en rectification d’erreur matérielle d’une de ses décisions ».
La décision n° 2017-681 QPC du 15 décembre 2017, Société Marlin, avait jugé que la disposition contestée relative à l’exonération de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, était conforme à la constitution. L’entreprise Norbail-Immobilier était intervenue dans ce contentieux QPC. Si le conseil a bien admis la rectification d’erreur matérielle à propos de l’inversion des parties intervenantes au paragraphe 3 de la décision 681 QPC, il a considéré que la demande visant à faire réexaminer les motifs de sa décision parce que le conseil n’aurait pas répondu aux griefs invoqués du fait de cette inversion conduisait à une remise en cause de la décision du 15 décembre 2017 et a rejeté, pour cette raison, cette conclusion.
MV
I – Les institutions constitutionnelles
A – Les pouvoirs politiques : le pouvoir exécutif (…)
B – Les pouvoirs politiques : le Parlement et la procédure législative
1 – Les validations législatives (…)
2 – Le contrôle de la procédure législative
3 – La compétence et le domaine de la loi
C – Le pouvoir juridictionnel (…)
D – Le pouvoir financier
E – Les collectivités décentralisées
F – Droits électoraux, contentieux des élections et des référendums
II – Le procès constitutionnel
A – Les acteurs et les actes devant le Conseil constitutionnel
B – Les techniques contentieuses et la procédure
C – L’autorité et les effets des décisions du Conseil constitutionnel
III – Les normes de références
A – Les sources matérielles
1 – Les textes constitutionnels
2 – Les rapports de systèmes
B – Les droits et libertés
1 – Les libertés
a – Sécurité et libertés
b – Liberté individuelle, respect de la vie privée, principe de responsabilité
c – Liberté d’expression / Liberté de conscience
d – Liberté d’entreprendre, liberté contractuelle
2 – Le droit de propriété
3 – Le principe d’égalité
a – Principe d’égalité devant la loi
b – Principe d’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques – Droits et libertés en matière fiscale
4 – Les droits sociaux
5 – Les principes du droit répressif
a – Principes de légalité, nécessité et individualisation des délits et des peines
Déc. n° 694 QPC du 2 mars 2018, M. Ousmane K. et autres. La décision du Conseil constitutionnel n° 694 QPC du 2 mars 2018, M. Ousmane K. et autres, intéresse la motivation des décisions rendues par les cours d’assises. Le Conseil a été saisi le 28 décembre 2017 par un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2017, d’une QPC posée devant elle à l’occasion de pourvois en cassation. Trois arrêts de cours d’assises différentes avaient condamné, au cours de l’année 2017, les auteurs de la QPC à des peines de réclusion criminelle. Si, en effet, l’article 23-1 alinéa 4 de l’ordonnance portant loi organique sur le Conseil constitutionnel n° 58-1067 du 7 novembre 1958 interdit qu’une QPC soit posée devant une cour d’assises, il permet néanmoins : « En cas d’appel d’un arrêt rendu par la cour d’assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation ».
Étaient en cause les deux articles 362 et 365-1 du Code de procédure pénale (ci-après CPP). Le premier est relatif à l’application de la peine prononcée par une cour d’assises, après la réponse affirmative de culpabilité à l’encontre d’un accusé. Son alinéa 1er a été modifié par l’article 3 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. Dans le cadre du contrôle a priori, cette loi a fait l’objet de la décision n° 2014-696 DC du 7 août 2014 du Conseil constitutionnel, mais celle-ci ne s’est pas spécialement prononcée sur cet article de la loi.
L’article 365-1 concerne, quant à lui, la motivation des décisions de cours d’assises. Son deuxième alinéa dispose que : « En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l’article 356-I, préalablement aux votes sur les questions ». Cet article était, quant à lui, issu de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. Cette loi avait aussi fait l’objet d’une saisine a priori mais, à la différence de la décision n° 2014-696 DC, le Conseil s’était spécialement prononcé sur la conformité de cet article mais pas sur la question de l’obligation ou non de la motivation de la peine1. Elle ne s’était intéressée qu’à la possibilité de reporter de trois jours la rédaction de la motivation pour estimer que l’article 365-1 du Code de procédure pénale devait être déclaré conforme à la constitution (cons. 30 et 31).
Les auteurs de la QPC examinée dans la décision n° 694 QPC soutenaient que les dispositions de ces deux articles n’imposaient pas la motivation de la peine et portaient ainsi atteinte aux principes de nécessité et de légalité des peines, au principe d’individualisation des peines, au droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense et au principe d’égalité devant la loi et devant la justice (§ 4). Le Conseil constitutionnel a néanmoins décidé que la QPC ne portait que sur l’article 365-1, alors que la Cour de cassation n’avait pas distingué ces deux articles dans son arrêt de renvoi du 13 décembre 2017.
L’une des conditions du renvoi d’une QPC par l’article 23-2 de l’ordonnance précitée du 7 novembre 1958, à savoir, celle selon laquelle la disposition contestée « ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances », ne semblait donc pas, de prime abord, remplie. Dans sa décision n° 694 QPC, le Conseil constitutionnel a cependant estimé qu’il y avait bien « changement de circonstances », ré-ouvrant ainsi le débat constitutionnel sur la question de la motivation de la peine.
I. La motivation renforcée des décisions des cours d’assises
L’absence de motivation des décisions des cours d’assises a longtemps été une des spécificités de ces juridictions, du fait notamment de la composition particulière des cours d’assises qui comportent des jurés, c’est-à-dire des juges non professionnels. La loi française a commencé à évoluer sous l’effet de la loi précitée du 10 août 2011 qui a imposé, en insérant un nouvel article 365-1 CPP, une motivation en cas de condamnation, mais qui avait paru distinguer la motivation de la culpabilité et celle de la peine.
Parallèlement, le Conseil constitutionnel avait jugé, à propos cette fois des articles 353 et 357 du Code de procédure pénale, que l’absence de motivation pouvait se justifier lorsqu’existaient des garanties de nature à exclure l’arbitraire, ce qui était le cas dans l’espèce considérée2. Le considérant 11 de cette décision avait ainsi affirmé que « l’obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation constitue une garantie légale de cette exigence constitutionnelle ; que, si la constitution ne confère pas à cette obligation un caractère général et absolu, l’absence de motivation en la forme ne peut trouver de justification qu’à la condition que soient instituées par la loi des garanties propres à exclure l’arbitraire ».
Pour pouvoir statuer, à nouveau, sur la constitutionnalité de l’article 365-1, le Conseil constitutionnel a été conduit à faire référence à l’interprétation jurisprudentielle de cet article par la Cour de cassation, sous l’angle de la condition de la recevabilité de la QPC et pour considérer que la disposition litigieuse était contraire à la constitution.
L’article 23-2 de l’ordonnance organique interdit que soit posée une QPC contre une disposition sur laquelle le Conseil constitutionnel a déjà statué, au nom de l’autorité de ses décisions. Mais il laisse une porte ouverte au réexamen d’une disposition législative en cas de changement de circonstances, dont le Conseil constitutionnel a précisé qu’il pouvait être « de droit ou de fait ». Le Conseil n’a pas tardé à faire utilisation de cette possibilité sur laquelle il se prononce expressément car il s’estime compétent pour statuer sur sa propre jurisprudence. Depuis 2010, les cas d’admission du changement de circonstances ne sont pas négligeables mais toute la difficulté réside dans l’appréciation du changement.
Dans l’espèce considérée, deux éléments motivent l’existence de ce changement de circonstances de droit. Le Conseil constitutionnel a estimé, en effet, que, d’une part, le premier alinéa de l’article 362 CPP a été modifié par la loi de 2014 précitée et que, d’autre part, la Cour de cassation dans trois arrêts du 8 février 2017 a jugé que l’article 365-1, alinéa 2 interdisait, selon les termes de la Cour, la motivation des arrêts des cours d’assises.
L’article 362 modifié en 2014 prévoit désormais que le président de la cour d’assises, en cas de décision de culpabilité, doit donner lecture aux jurés des articles 130-1 et 132-1 du Code pénal. Ceux-ci, créés ou modifiés par la même loi de 2014, précisent les finalités de la peine et la nécessaire individualisation de celle-ci, ce dernier objectif correspondant au titre même de la loi de 2014 : l’article 130-1 prévoit quelles sont les fonctions de la peine, à la fois sanctionner l’auteur de l’infraction et favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. L’article 132-1 dispose notamment que : « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée » et qu’elle doit tenir compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
Le Conseil constitutionnel en a alors déduit que le rappel des objectifs de la peine criminelle opéré par le président de la juridiction criminelle peut être, au stade de l’examen de la recevabilité de la QPC, compris comme une justification de la motivation de la peine, et non pas seulement de la culpabilité. Si la peine doit être individualisée selon l’esprit de la loi de 2014, il faut aussi qu’elle soit motivée. L’intervention d’une loi postérieure au premier examen de l’article 365-1 par la décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011 est donc de nature à justifier un nouvel examen de cet article, ce qui constitue une première justification du changement de circonstances.
D’autre part, les arrêts de la Cour de cassation du 8 février 2017 sont intervenus, quant à eux, dans un contexte jurisprudentiel complexe. La Cour avait ainsi refusé de transmettre au Conseil constitutionnel des QPC fondées sur l’absence de motivation3, alors que la même juridiction avait adopté une jurisprudence différente s’agissant des décisions rendues par les juridictions correctionnelles. La Cour avait ainsi imposé, dans trois arrêts du 1er février 2017, la motivation de toute peine prononcée en matière correctionnelle en se fondant sur les critères d’individualisation des peines fixés par les articles 132-1 alinéa 3 et 132-20 alinéa 2 du Code pénal, faisant référence à « l’exigence, résultant des articles 132-1 du Code pénal et 485 du Code de procédure pénale, selon laquelle en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle »4.
En matière criminelle, la Cour de cassation avait, en revanche, jugé, sur le fondement de l’article 365-1 CPP, que « selon ce texte, en cas de condamnation par la cour d’assises, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui l’ont convaincue de la culpabilité de l’accusé ; qu’en l’absence d’autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu’ils prononcent dans les conditions définies à l’article 362 du code susvisé »5. Dans ces trois arrêts, la Cour avait cassé les arrêts de cours d’assises qui avaient jugé que la peine devait être motivée, la Cour de cassation jugeant qu’ils ne « doivent pas motiver ».
La proximité des dates de ces décisions, 1er février 2017 d’une part, 8 février 2017 d’autre part, rendues à propos de deux catégories distinctes d’infractions jugées par des juridictions différentes ne pouvait que souligner l’intention de la Cour de cassation de traiter différemment la motivation des peines.
La jurisprudence de la Cour de cassation interdisant la motivation constituait donc la deuxième raison justifiant la réouverture de l’examen de l’article 365-1 du CPP.
II. La méconnaissance des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits par l’absence de motivation des décisions de cours d’assises
Cette jurisprudence, constante seulement en ce qu’elle repose sur trois arrêts récents rendus le même jour, révèle les inconstitutionnalités de la loi. C’est ainsi l’intention du législateur exprimée dans la loi de 2011 qui est sanctionnée, telle qu’elle est révélée par la Cour de cassation, alors même que ce dernier n’excluait pas expressément cette motivation.
Elle permet aussi au Conseil constitutionnel, en rupture avec sa jurisprudence issue de la décision du 1er avril 2011 précitée, d’affirmer qu’en n’imposant pas à la cour d’assises de motiver le choix de la peine, « le législateur a méconnu les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le deuxième alinéa de l’article 365-1 du Code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la constitution » (§ 10). Les articles 7 à 9 de la Déclaration considérés de manière globale par le Conseil ont été méconnus par la loi ainsi revisitée. Ces articles intéressent les principes de nécessité et de légalité des peines, celui de l’individualisation des peines (art. 8), le droit à une procédure équitable et aux droits de la défense (art. 7 à 9). Pour le Conseil, le principe d’individualisation des peines doit conduire à la motivation de celles-ci et pas seulement à celle de la décision de culpabilité. La motivation de sa décision, sur le fond, est assez succincte, ce qui peut paraître surprenant pour une décision imposant la motivation complète aux décisions des cours d’assises.
Les requérants invoquaient aussi la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant la justice (§ 4). Sans doute était-ce un écho de la jurisprudence de la Cour, distinguant l’interdiction de la motivation de l’application de la peine en matière criminelle et l’obligation de motivation des mêmes sanctions mais prononcées en matière correctionnelle (arrêts précités du 1er février 2017 de la chambre criminelle). Le Conseil constitutionnel ne s’est cependant pas arrêté à cet argument tiré des principes d’égalité par sa formule habituelle, en statuant « sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs ».
Ainsi la jurisprudence constante de la Cour de cassation sert à la fois de justification au changement de circonstances mais aussi de motivation de l’inconstitutionnalité. La Cour a fait une exacte application de la loi qui est, elle, contraire à la constitution. La loi a donc, telle qu’elle a été bien comprise et interprétée par la Cour de cassation, en imposant la motivation de la décision de culpabilité, entendu exclure parallèlement la motivation de la décision relative à la peine. Néanmoins, il est possible de penser que c’est cette interprétation qui « éclaire » l’inconstitutionnalité et qui permet de la détecter. Tout en faisant référence à cette jurisprudence et à ce qu’il est convenu d’appeler une utilisation française de la doctrine italienne du droit vivant, le Conseil se garde bien de censurer la jurisprudence de la Cour et, par là même, la juridiction suprême de l’ordre judiciaire mais il déclare l’inconstitutionnalité de la disposition législative.
Afin de rendre accessibles les effets dans le temps de la décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, le site Légifrance publie un « Nota » après l’article 365-1 qui reprend les termes des articles 1er et 2 du dispositif de la décision, mais qui constitue aussi une sorte de résumé des paragraphes 12 à 14 de l’exposé des motifs auxquels renvoient ces articles, servant ainsi de guide de lecture de cette disposition pour les juridictions amenées à l’appliquer.
En conséquence, la disposition de l’article 365-1 du CPP, ainsi déclarée contraire à la constitution, « devrait » disparaître de l’ordonnancement juridique. Mais le principe de l’effet utile de l’abrogation est, fréquemment, assorti d’une nuance importante, faisant prévaloir le respect du principe de sécurité juridique sur les préoccupations tenant aux droits, ou aux intérêts immédiats, des justiciables. Le Conseil peut ainsi décider que l’abrogation immédiate est susceptible d’avoir des effets plus négatifs que le maintien – même temporaire – du droit jusque-là en vigueur. Dans le cas de l’article 365-1, cette abrogation immédiate de l’alinéa 1er aurait « pour effet de supprimer les modalités selon lesquelles, en cas de condamnation, la motivation d’un arrêt de cour d’assises doit être rédigée en ce qui concerne la culpabilité. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives » (§ 12). Elle priverait en effet de base légale l’exigence de motivation de la décision de culpabilité et constituerait un retour en arrière par rapport à la loi du 10 août 2011 (sur ce point, v. la rubrique : Le procès constitutionnel).
L’article 62 de la constitution permet aussi au Conseil d’imposer aux juridictions d’assises sa propre interprétation du texte abrogé et la manière dont il conçoit qu’elle doit être appliquée en distinguant les différentes hypothèses possibles. Le Conseil constitutionnel a opéré une distinction aux effets subtils entre les procès ouverts après la date de publication de la décision, soit le 2 mars 2018, et ceux rendus en dernier ressort avant cette date ou ceux rendus à l’issue d’un procès ouvert avant la même date.
Pour les procès postérieurs à cette date, le Conseil constitutionnel propose – en réalité impose – aux juridictions criminelles une lecture de l’article 365-1 du CPP qui aboutit à le priver d’effet, alors même que le texte reste en vigueur en théorie jusqu’au 1er mars 2019 : cet article doit être en effet interprété comme imposant, pour ces procès à venir, une obligation de motivation des prononcés des peines par les cours d’assises.
Cette relecture de la loi revient en fait à rendre obligatoire la motivation du choix de la peine jusqu’à l’adoption d’une nouvelle législation allant dans le sens d’une obligation de motivation des peines criminelles. Le Conseil entend ainsi garantir le respect des intérêts que peut – ou doit ? – avoir la motivation des peines que sont la confiance dans la justice, la nécessité de comprendre les peines les plus graves prononcées en matière criminelle, et une meilleure appréciation des voies de recours que sont l’appel et la cassation.
En revanche, pour les procès en cours, ou ceux rendus en dernier ressort, mais donc avant un éventuel pourvoi en cassation, le Conseil décide au nom du principe de sécurité juridique que les arrêts ne pourront pas être contestés sur le fondement de l’inconstitutionnalité de l’article 365-1 du CPP. Pour MM. K., B. et C., à l’origine de la décision n° 694 QPC, la déclaration d’inconstitutionnalité ne leur aura pas profité. Les décisions rendues par les cours d’assises, comme celles de n’importe quelle juridiction, devront être motivées aussi bien en ce qui concerne la culpabilité que la peine. Il s’agit bien de la fin d’un mythe selon lequel l’opinion des jurés, expression de la souveraineté populaire, ne saurait errer.
La QPC posée par M. Axel N. dans la décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018 est relative à la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit du 3° de l’article L. 232-22 du Code du sport, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du Code mondial antidopage et elle intéresse la saisine d’office de l’agence française de lutte contre le dopage et réformation des sanctions disciplinaires prononcées par les fédérations sportives.
Si l’article L. 232-21 du Code du sport confie aux fédérations sportives agréées le prononcé de sanctions disciplinaires en matière de dopage, l’article L. 232-22 du Code du sport détermine quant à lui, les cas dans lesquels l’agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction. Son 3° prévoit : « Elle peut réformer les décisions prises en application de l’article L. 232-21. Dans ces cas, l’agence se saisit, dans un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées ».
Il était reproché à ces dispositions de méconnaître les principes d’indépendance et d’impartialité qui découlent de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. En ne distinguant pas, au sein de l’agence française de lutte contre le dopage, l’autorité décidant de la saisine d’office de l’agence et celle chargée du jugement à la suite de cette saisine, le législateur n’aurait pas garanti une séparation organique ou fonctionnelle entre les fonctions de poursuite et de jugement.
Tout en rappelant qu’aucun principe ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative ou publique indépendante, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission, le Conseil précise que c’est à la condition que l’exercice de ce pouvoir soit assorti de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis. Parmi ceux-ci figurent en particulier le principe de légalité des délits et des peines et les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d’une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle, mais aussi les principes d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 (§ 4). C’est sur ce dernier point que le 3° de l’article L. 232-22 du Code du sport a été déclaré contraire à la constitution (V. rubrique Droits processuels).
On pourra relever ici que les principes applicables en matière répressive, dont celui relatif à la légalité des délits et des peines, tirés de l’article 8 de la Déclaration des droits, doivent recevoir application devant des instances administratives qui sont amenées à prononcer des sanctions.
L’Association de la presse judiciaire contestait, à l’occasion d’un recours contre la circulaire devant le Conseil d’État, la constitutionnalité de l’article 11 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, et de l’article 56 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. Ces dispositions sont relatives au secret de l’instruction et aux perquisitions menées dans le cadre d’une enquête judiciaire. L’association requérante reprochait à ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, d’interdire toute présence d’un journaliste ou d’un tiers lors d’une perquisition, pour en capter le son ou l’image, même lorsque cette présence a été autorisée par l’autorité publique et par la personne concernée par la perquisition.
Si la décision n° 2017-693 QPC du 2 mars 2018 est surtout relative à la protection de la liberté de communication6, le Conseil en profite pour indiquer que le secret de l’instruction, que les mesures contestées entendaient protéger, vise à permettre le bon déroulement de l’enquête et de l’instruction, et protéger les personnes concernées par une enquête ou une instruction, afin de garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence, qui résulte des articles 2 pour la vie privée et 9 de la Déclaration de 1789 pour la présomption d’innocence. Sans doute ce rappel n’est-il pas inutile dans cette période où la moindre « affaire » ou le premier soupçon sont étalés sur la place publique, causant des dégâts collatéraux parfois irréparables.
À propos de l’article 421-2-5 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, et des articles 422-3 et 422-6 du même code, il était soutenu notamment, qu’en réprimant l’apologie d’actes de terrorisme, ces dispositions méconnaissaient le principe de légalité des délits et des peines, faute pour le législateur d’avoir suffisamment circonscrit le champ d’application de ce délit. En outre, les peines principales et complémentaires sanctionnant ce délit contreviendraient aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines (sur le grief d’atteinte à la liberté d’expression, v. rubrique Libertés).
Dans la décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018, M. Jean-Marc R., le Conseil rappelle que le principe de légalité des délits et des peines trouve son fondement à la fois dans l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, selon lequel nul « ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » et dans l’article 34 de la constitution : « La loi fixe les règles concernant (…) la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables », ce dernier ne faisant que fixer une compétence normative sans avoir pour objet de préciser ce principe. Selon l’interprétation habituelle du Conseil, rappelée au paragraphe 7 de la décision, ces deux dispositions imposent au législateur « l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire ».
Dans le cas d’espèce, le délit d’apologie publique d’actes de terrorisme est constitué dès lors que plusieurs éléments sont réunis. D’une part, le comportement incriminé doit inciter à porter un jugement favorable sur une infraction expressément qualifiée par la loi d’« acte de terrorisme » ou sur son auteur. D’autre part, ce comportement doit se matérialiser par des propos, images ou actes présentant un caractère public, c’est-à-dire dans des circonstances traduisant la volonté de leur auteur de les rendre publics. Le Conseil en a déduit que les dispositions contestées de l’article 421-2-5 du Code pénal ne revêtent pas un caractère équivoque et étaient suffisamment précises pour garantir contre le risque d’arbitraire (§ 10).
Les principes de nécessité et de proportionnalité des peines sont également et directement issus de l’article 8 de la Déclaration des droits qui dispose que : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires (…) ». Cette disposition confie à la loi le soin de fixer les peines, ce qui conduit le Conseil constitutionnel à reconnaître au législateur une marge de manœuvre sur laquelle il ne peut exercer qu’un contrôle restreint. Pour se justifier, le Conseil rappelle dans cette décision, comme dans de nombreuses décisions précédentes7, que l’article 61-1 de la constitution ne lui confère pas un « pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la constitution des lois déférées à son examen. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue » (§ 11). Sur ce fondement, le Conseil a jugé que le législateur avait pris en compte l’ampleur particulière de la diffusion des messages prohibés que permet le service de communication au public en ligne, ainsi que son influence dans le processus d’endoctrinement d’individus susceptibles de commettre des actes de terrorisme. Les peines complémentaires prévues à l’article 422-3 du Code pénal, à savoir, pour une durée maximum de 10 ans, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise et l’interdiction de séjour « qui sont prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ne sont pas manifestement disproportionnées » (§ 14). Il en est de même de la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens appartenant aux personnes coupables d’actes de terrorisme8 ou dont elles ont la libre disposition, eu égard à la gravité des infractions constituant des actes de terrorisme (§ 17). Le grief tiré de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines par l’article 422-6 du Code pénal a été écarté.
La méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines en raison de l’imprécision des termes de la loi a été invoquée par l’association Al Badr et M. Abdelfattah R. dans la décision n° 2018-710 QPC du 1er juin 2018 à propos de la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit de l’article 227-17-1 du Code pénal relatif à la répression de l’obligation scolaire des enfants mineurs. Son alinéa 2, seul retenu par le Conseil dans cette QPC, réprime le fait pour le directeur d’un établissement privé d’enseignement accueillant des classes hors contrat de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, les dispositions nécessaires pour assurer un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire et de n’avoir pas procédé à la fermeture de ces classes.
Le Conseil y a rappelé sa définition du principe de légalité des délits et des peines rappelé dans les décisions précédentes (§ 5). Par une réserve d’interprétation neutralisante, le Conseil a jugé que les dispositions instituant le délit contesté ne revêtaient pas un caractère équivoque et étaient suffisamment précises pour garantir contre le risque d’arbitraire. Pour que les dispositions contestées ne soient pas contraires au principe et afin de « sauver la loi », la mise en demeure adressée au directeur de l’établissement doit en effet exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit mis en conformité avec l’objet de l’instruction obligatoire (§ 9). C’est à cette condition que l’alinéa 2 de l’article 227-17-1 du Code pénal est conforme à la constitution.
Les requérants invoquaient à l’encontre de la disposition visant l’interdiction encourue par le directeur d’un tel établissement d’enseigner ou de diriger et la fermeture d’établissement, qui constituent des peines complémentaires à la sanction principale – à savoir 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende –, la méconnaissance des principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines. Tout en reprenant la limitation de ses compétences, le Conseil a précisé que le principe d’individualisation, qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789, « implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions » (§ 16). Le Conseil précise que ces peines complémentaires peuvent être définitives ou limitées à une durée de 5 ans (par application du principe général posé par l’article 131-27 du Code pénal). Dans tous les cas, le juge, lorsqu’il décide de prononcer une ou plusieurs de ces peines complémentaires, en fixe la durée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Par conséquent, le principe d’individualisation des peines n’est pas méconnu et les peines ainsi instituées ne sont pas manifestement disproportionnées (§ 20).
Le Conseil estime que l’article 9 de la Déclaration des droits, selon lequel « présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable » et l’article 8 impliquent que « nul n’est punissable que de son propre fait », ce que ces dispositions ne prévoient pas expressément. Ce principe répressif trouve à s’appliquer lorsque la personne exploitant l’établissement d’enseignement n’est pas celle poursuivie sur le fondement des dispositions contestées. Dans ce cas, la mesure de fermeture de l’établissement, qui s’applique indirectement à la personne exploitant l’établissement d’enseignement, ne peut être prononcée sans que le ministère public ait cité cette personne devant le tribunal correctionnel en indiquant la nature des poursuites exercées et la possibilité pour ce tribunal de prononcer cette mesure. Ce n’est que sous cette seconde réserve, énoncée au paragraphe 23 et rappelée elle aussi au dispositif de la décision, que le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait n’est pas méconnu.
MV
b – Droits de la défense – sanctions ayant le caractère de punition
Le Conseil a prononcé la non-conformité totale des articles L. 138-24, L. 138-25 et L. 138-26 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, dans la décision n° 2018-703 QPC du 4 mai 2018 (Société People and Baby). Ces dispositions prévoient des sanctions pour les entreprises et les établissements publics qui n’emploient pas des salariés âgés. Pour autant, ces dispositions n’étaient plus en vigueur au moment de la décision, mais l’on sait que cette situation n’empêche pas le Conseil de statuer sur la conformité des dispositions législatives à la constitution.
Pour que ces mesures répressives soient soumises au principe de proportionnalité des peines, il faut que la sanction ait le caractère de punition. Le Conseil rappelle en effet que les principes énoncés par l’article 8 de la Déclaration des droits s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Tel est le cas dans l’espèce considérée, la pénalité sanctionnant le manquement à l’obligation posée par le Code de la sécurité sociale ayant le caractère d’une punition. Dans ces conditions, on voit mal alors quelle sanction n’aurait pas le caractère d’une punition entraînant l’application de l’article 8 de la Déclaration des droits.
Le Conseil a considéré que, dans l’espèce, le législateur avait instauré une sanction-pénalité égale à 1 % des rémunérations versées aux salariés au cours des périodes pendant lesquelles l’entreprise n’a pas été couverte par l’accord ou le plan exigé comportant notamment un objectif chiffré de maintien dans l’emploi ou de recrutement de salariés âgés – qui était susceptible d’être sans rapport avec la gravité du manquement réprimé, alors même que l’emploi des salariés âgés constitue « un objectif d’intérêt général » et était donc excessive, le juge ne pouvant pas les moduler (§ 11). Ce constat a suffi au Conseil pour considérer que les dispositions contestées méconnaissaient le principe de proportionnalité des peines et qu’elles devaient être déclarées contraires à la constitution.
MV
6 – Les droits processuels
a – Le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, l’égalité devant la justice et le principe d’impartialité et d’indépendance des juridictions
Le Conseil constitutionnel reconnaît, sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, un droit constitutionnel à un recours juridictionnel effectif9. Ce droit peut donc être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité10.
Dans la décision n° 2018-705 QPC du 1er juin 2018, Mme Arlette R. et a. (possibilité de clôturer l’instruction en dépit d’un appel pendant devant la chambre de l’instruction), le Conseil devait se prononcer sur la conformité à la constitution de l’article 187 du Code de procédure pénale (CPP). Cet article, tel qu’interprété par la Cour de cassation, permet que la clôture de l’instruction soit prononcée alors même qu’un recours contre une décision du juge d’instruction est pendant devant la chambre de l’instruction. Les requérantes estimaient ainsi que si l’instruction était close « avant qu’il ait été statué sur l’appel, ce dernier serait privé d’effet », ce qui méconnaîtrait le droit à un recours juridictionnel effectif, les droits de la défense et le principe d’égalité devant la loi (§ 2). En l’espèce, le Conseil a estimé qu’il n’y avait pas de violation de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Conformément à sa jurisprudence11, le Conseil s’assure que l’absence d’effet suspensif du recours ne prive pas d’effet le recours. Il a donc relevé que l’information peut être suspendue par le président de la chambre de l’instruction, le temps qu’il statue sur l’appel et que la clôture de l’information ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai minimum d’1 mois et 10 jours, durant lequel les parties peuvent informer le président de la chambre de l’instruction de l’imminence de la clôture (§ 8). Conformément à son appréciation in concreto, le Conseil tient compte des autres voies de recours dont disposent les intéressés pour apprécier la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif12. Il souligne en l’espèce qu’il est possible de contester les dispositions des ordonnances critiquées devant la chambre de l’instruction par d’autres voies de droit (§ 9). Enfin, il rappelle que lorsqu’une juridiction de jugement est saisie à la suite d’une information, les parties « peuvent toujours solliciter un supplément d’information ». En conséquence, il estime qu’elles peuvent « contester utilement, dans des délais appropriés, les décisions du juge d’instruction sur lesquelles la chambre de l’instruction n’a pas statué avant l’ordonnance de règlement » (§ 10). Le Conseil admet que le droit au recours soit restreint « afin d’éviter, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les recours dilatoires provoquant l’encombrement des juridictions et l’allongement des délais de jugement des auteurs d’infractions »13. En l’espèce, il estime donc que la restriction apportée au droit au recours n’est pas excessive car les dispositions en cause « ont pour objet d’éviter les recours dilatoires provoquant l’encombrement des juridictions et l’allongement des délais de jugement des auteurs d’infraction et mettent ainsi en œuvre l’objectif de bonne administration de la justice » (§ 11).
La décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018, Section française de l’observatoire international des prisons et autres (délai de recours et de jugement d’une obligation de quitter le territoire français notifiée à un étranger), était relative aux délais dans lesquels le juge administratif est saisi et statue sur le recours contre une obligation de quitter le territoire français (OQTF) lorsque l’intéressé est placé en détention. Ces délais sont prévus par le paragraphe IV de l’article L. 512-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, qui renvoie au paragraphe III de l’article L. 512-1 du CESEDA. D’après ces dispositions, le juge administratif, qui doit être saisi dans les 48 heures suivant la notification de l’OQTF, statue au plus tard 72 heures à compter de la saisine (§ 5). Le droit à un recours juridictionnel effectif ne recouvre pas simplement l’existence du recours, mais également les conditions dans lesquelles il s’exerce. Le Conseil exige par exemple que lorsqu’il s’agit de mesures privatives de liberté, le juge statue dans les plus brefs délais14. Néanmoins, des délais trop brefs de recours peuvent également faire l’objet d’une censure15. Dans cette décision, le Conseil censure des dispositions prévoyant des délais de recours, mais aussi de jugement, trop brefs. Le Conseil a estimé que l’objectif poursuivi par le législateur était d’assurer l’exécution de l’OQTF et d’éviter qu’un étranger détenu soit placé en rétention administrative à l’issue de sa détention en attendant que le juge se prononce sur son recours (§ 6). Le Conseil relève néanmoins qu’au maximum, l’intéressé ne dispose que d’un délai de 5 jours entre la notification de l’OQTF et le moment où le juge statue. Il considère qu’il s’agit d’un « délai particulièrement bref pour exposer au juge ses arguments et réunir les preuves au soutien de ceux-ci » (§ 7). Cette brièveté ne semble pas justifiée par l’objectif poursuivi d’après le Conseil. Il relève que l’Administration « peut notifier à l’étranger détenu une obligation de quitter le territoire français sans attendre les derniers temps de la détention » et « donc, lorsque la durée de la détention le permet, procéder à cette notification suffisamment tôt au cours de l’incarcération tout en reportant son exécution à la fin de celle-ci » (§ 8). Ils estiment donc que rien ne justifiait que de tels délais s’appliquent « quelle que soit la durée de la détention » et considère en conséquence que les dispositions en cause : « n’opèrent pas une conciliation équilibrée entre le droit au recours juridictionnel effectif et l’objectif poursuivi par le législateur d’éviter le placement de l’étranger en rétention administrative à l’issue de sa détention » (§ 9). Il les a donc déclarées contraires à la constitution (§ 10), avec effet différé (§ 11-12).
La décision n° 2018-712 QPC du 8 juin 2018, M. Thierry D. (irrecevabilité de l’opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est prescrite), concernait l’article 492 du CPP, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008, et l’article 133-5 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992. Ces articles prévoient que, lorsque la peine est prescrite, le condamné ne peut plus former opposition, alors même qu’il aurait été condamné par défaut et n’aurait jamais eu connaissance de sa condamnation. Le Conseil examine la conformité de ces dispositions à l’article 16 de la Déclaration, duquel découle le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense (§ 6)16. Le Conseil, après avoir rappelé le cadre juridique de l’appel et de l’opposition contre les condamnations pénales dans le cas d’une condamnation par défaut (§ 7-8), relève que lorsque la peine est prescrite, l’opposition de la personne condamnée par défaut n’est plus recevable, « tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, alors même que la personne condamnée n’a jamais eu connaissance de ce jugement avant cette prescription » (§ 9). Il souligne également que le délai d’appel peut commencer à courir « à l’encontre d’une personne condamnée par défaut alors même qu’elle n’a pas eu connaissance de la signification du jugement » (§ 10). La personne condamnée par défaut est donc bien dans l’incapacité de contester la décision de condamnation, que ce soit par la voie de l’opposition ou de l’appel, lorsqu’elle n’en prend connaissance qu’une fois que la peine est prescrite (§ 11). En outre, le Conseil souligne qu’« une peine, même prescrite, est susceptible d’emporter des conséquences pour la personne condamnée » et que si elle est assortie d’une condamnation civile, sa prescription n’éteint pas l’action du créancier bénéficiaire des dommages et intérêts (§ 12). Le Conseil estime donc qu’étant donné que « des conséquences restent attachées à une peine même prescrite », la personne condamnée doit pouvoir la contester, y compris lorsqu’elle prend connaissance de la condamnation une fois la peine prescrite. Il censure donc les dispositions en ce qu’elles « portent une atteinte excessive aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif » (§ 13), avec effet différé (§ 15-16).
Dans la décision n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018, Section française de l’Observatoire international des prisons (restrictions des communications des personnes détenues), le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de revenir sur le droit de communication des prévenus et condamnés. Il était saisi de l’article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 qui prévoit que l’autorité judiciaire peut s’opposer à ce que les personnes prévenues puissent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix (§ 1). Le Conseil relève qu’« aucune autre disposition législative ne permet de contester devant une juridiction une décision refusant l’exercice de ce droit » (§ 5). En 2016, il avait été saisi de dispositions similaires qui ne prévoyaient pas de recours contre le refus de délivrance des permis de visite et des autorisations de téléphoner au profit des personnes placées en détention provisoire. Il les avait alors censurées comme méconnaissant les exigences découlant de l’article 1617. Suivant le même raisonnement, il estime en l’espèce qu’« au regard des conséquences qu’entraîne ce refus pour une personne placée en détention provisoire, l’absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du magistrat conduit dès lors à ce que les dispositions contestées méconnaissent les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 » (§ 6). Les dispositions en cause ont donc été déclarées inconstitutionnelles (§ 7), avec effet différé (§ 8-9). Le Conseil règle également la période transitoire en ouvrant une voie de recours provisoire contre ces décisions devant le président de la chambre de l’instruction dans les conditions prévues par la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 145-4 du CPP (§ 10).
Dans la décision n° 2018-704 QPC du 4 mai 2018, le Conseil était saisi du 3° de l’article L. 232-22 du Code du sport, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015. Ces dispositions prévoient que l’agence française de lutte contre le dopage peut se saisir d’office pour réformer les décisions de sanctions disciplinaires prononcées par les fédérations sportives agrées (§ 1). Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une autorité administrative ou publique indépendante exerce un pouvoir de sanction, les principes d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doivent être respectés18. Le principe d’impartialité implique notamment « la séparation au sein de l’autorité entre, d’une part, les fonctions de poursuite et d’instruction des éventuels manquements et, d’autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements »19. Le Conseil fait ici application de cette jurisprudence. Après avoir relevé que les dispositions contestées n’opéraient aucune séparation, au sein de l’agence française de lutte contre le dopage, entre les fonctions de poursuite des éventuels manquements et celles de jugement de ces mêmes manquements, il a estimé qu’elles méconnaissaient le principe d’impartialité (§ 9). Il les a donc déclarées inconstitutionnelles (§ 10), avec effet différé (§ 11-12). Il a également fixé le régime transitoire en prévoyant que l’autorité serait saisie de toutes les décisions et que la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances relatives à une décision rendue en application des dispositions censurées (§ 13).
La décision n° 2018-704 QPC du 4 mai 2018, M. Franck B. et a. (obligation pour l’avocat commis d’office de faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le président de la cour d’assises), est relative à l’article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui prévoit que pour refuser son ministère, l’avocat commis d’office par le bâtonnier ou par le président de la cour d’assises doit faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le bâtonnier ou par le président de la cour d’assises. La question était limitée aux compétences du président de la cour d’assises (§ 3). Les requérants et intervenants estimaient notamment « que le pouvoir discrétionnaire reconnu au président de la cour d’assises de juger des motifs d’excuse ou d’empêchement présentés par un avocat commis d’office méconnaîtrait les droits de la défense », le principe d’impartialité (§ 2), le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif (§ 4). Sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration de 1789, le Conseil fonde le droit à un recours juridictionnel effectif, les droits de la défense20 et le droit à un procès équitable21 ainsi que le principe d’impartialité qui est indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles22 (§ 5). Le Conseil rappelle que l’interprétation de la jurisprudence constante de la Cour de cassation23 est de considérer que lorsque l’avocat refuse son ministère après avoir été commis d’office par le président de la cour d’assises, ce dernier est « seul compétent pour admettre ou refuser les motifs d’excuse ou d’empêchement invoqués par l’avocat ». Il souligne également que « l’avocat qui ne respecte pas sa commission d’office encourt une sanction disciplinaire » (§ 6). Le Conseil estime que ces mesures « mettent en œuvre l’objectif de bonne administration de la justice ainsi que les exigences qui s’attachent au respect des droits de la défense » (§ 7) en permettant au président de la cour d’assises d’écarter les demandes qui lui paraissent infondées. En l’espèce, il estime qu’il n’y a pas d’atteinte aux exigences de l’article 16 (§ 11). S’agissant des droits de la défense, ils sont protégés car l’avocat exerce son ministère librement, les obligations de son serment lui interdisent de révéler un élément susceptible de nuire à la défense de l’accusé, au titre d’un motif d’excuse ou d’empêchement et l’accusé peut à tout moment choisir un autre avocat (§ 8). Quant au droit au recours, si le refus du président de la cour d’assises n’est pas, en lui-même, susceptible de recours, la régularité du refus pourra être ultérieurement contestée, tant par l’accusé dans le cadre d’un pourvoi, que par l’avocat dans le cadre d’une éventuelle procédure disciplinaire (§ 9). Ce recours est ténu puisqu’en l’absence de pourvoi ou de procédure disciplinaire, il est impossible de contester la décision, mais le Conseil admet fréquemment d’importantes restrictions du droit au recours au nom de l’objectif de bonne administration de la justice24. Enfin, s’agissant du principe d’impartialité, le Conseil a estimé qu’il n’était pas remis en cause par le pouvoir conféré au président, « compte tenu du rôle qui est le sien dans la conduite du procès » (§ 10). Les dispositions ont donc été déclarées conformes à la constitution (§ 12).
b – Le principe de sécurité juridique
Depuis sa décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006, le Conseil constitutionnel considère que la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 implique que le législateur ne doit pas porter aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant. Depuis sa décision n° 2013-336 QPC en date du 19 décembre 2013, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, il estime que la garantie des droits implique également que le législateur ne remette pas en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations, sans motif d’intérêt général suffisant.
La décision n° 2018-700 QPC du 13 avril 2018, Société Technicolor (report en avant des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés en cas d’abandons de créances), concernait le paragraphe II de l’article 17 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016. Cet article prévoit que les dispositions du paragraphe I de ce même article ont un caractère interprétatif. Les dispositions du paragraphe I avaient pour objet de modifier le dernier alinéa de l’article 209 du Code général des impôts qui détermine quelles entreprises peuvent bénéficier d’une majoration du montant déductible du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés, en application du dispositif de report en avant des déficits. Le Conseil a estimé que cette modification avait pour objet de « lever toute ambiguïté sur la détermination des sociétés bénéficiaires de cette majoration » (§ 8) et avait simplement remplacé les dispositions précédentes « par d’autres, plus claires, ayant le même objet et la même portée » (§ 8). Pour le Conseil, si la formulation change, les normes restent inchangées. Ces dispositions peuvent donc avoir un effet rétroactif « sans porter d’atteinte à des situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations » (§ 8).
MB
Notes de bas de pages
-
1.
Cons. const., 4 août 2011, n° 2011-635 DC, cons. 29 et s.
-
2.
Cons. const., 1er avr. 2011, n° 2011-113/115 QPC, M. Xavier P. et a., à propos de la motivation des arrêts d’assises, relativement à plusieurs articles du Code de procédure pénale.
-
3.
Cass. crim., 19 mai 2010, n° 09-82582 QPC, M. Yvan Colona.
-
4.
Cass. crim., 1er févr. 2017, n° 15-84511, M. Luc X. Même motivation dans l’arrêt 15-85-199 du même jour, M. Christian X. Dans l’arrêt n° 15-83984, Mme Malika X. et a., la Cour a jugé « qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ».
-
5.
Cass. crim., 8 févr. 2017, n° 15-86914 : Bull. crim., n° 377. M. Kaies X. Motivation identique dans les deux arrêts du 8 févr. 2017, n° 16-80389, M. Jean X et n° 16-80391, M. Joël X.
-
6.
V. Rubrique Libertés.
-
7.
V. Chroniques précédentes.
-
8.
C. pén, art. 422-6.
-
9.
Implicitement : Cons. const., 21 janv. 1994, n° 93-335 DC, loi portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction et, explicitement : Cons. const., 9 avr. 1996, n° 96-373 DC, loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cons. 83.
-
10.
Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC.
-
11.
V. par ex. Cons. const., 2 juin 2017, n° 2017-632 QPC, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés (procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d’arrêt des traitements d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté).
-
12.
V. par ex. Cons. const., 18 mai 2016, n° 2016-541 QPC, Société Euroshipping Charter Company Inc et autre (visite des navires par les agents des douanes II).
-
13.
Cons. const., 13 juill. 2011, n° 2011-153 QPC, M. Samir A. (appel des ordonnances du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention), cons. 5.
-
14.
Cons. const., 26 nov. 2010, n° 2010-71 QPC, Mme Danielle S. (hospitalisation sans consentement), cons. 39.
-
15.
V. cette chronique Commentaire de Cons. const., 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC, M. Rouchdi B. et a. (mesures administratives de lutte contre le terrorisme).
-
16.
Cons. const., 30 mars 2006, n° 2006-535 DC, loi pour l’égalité des chances, cons. 41.
-
17.
Cons. const., 24 mai 2016, n° 2016-543 QPC, Section française de l’observatoire international des prisons (permis de visite et autorisation de téléphoner durant la détention provisoire), § 14.
-
18.
V. par ex. Cons. const., 12 oct. 2012, n° 2012-280 QPC, Société Groupe Canal Plus et autre (autorité de la concurrence : organisation et pouvoir de sanction), cons. 16.
-
19.
Cons. const., 5 juill. 2013, n° 2013-331 QPC, société Numéricable SAS et a. (pouvoir de sanction de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes), cons. 12.
-
20.
V. par ex. Cons. const., 30 mars 2006, n° 2006-535 DC, loi pour l’égalité des chances, cons. 24.
-
21.
V. par ex. Cons. const., 27 juill. 2006, n° 2006-540 DC, loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, cons. 11.
-
22.
V. par ex., Cons. const., 26 mars 2006, n° 2010-110 QPC, M. Jean-Pierre B. (composition de la commission départementale d’aide sociale), cons. 3.
-
23.
Cass. 1re civ., 9 févr. 1988, n° 86-17786.
-
24.
V. Cons. const., 1er juin 2018, n° 2018-705 QPC.