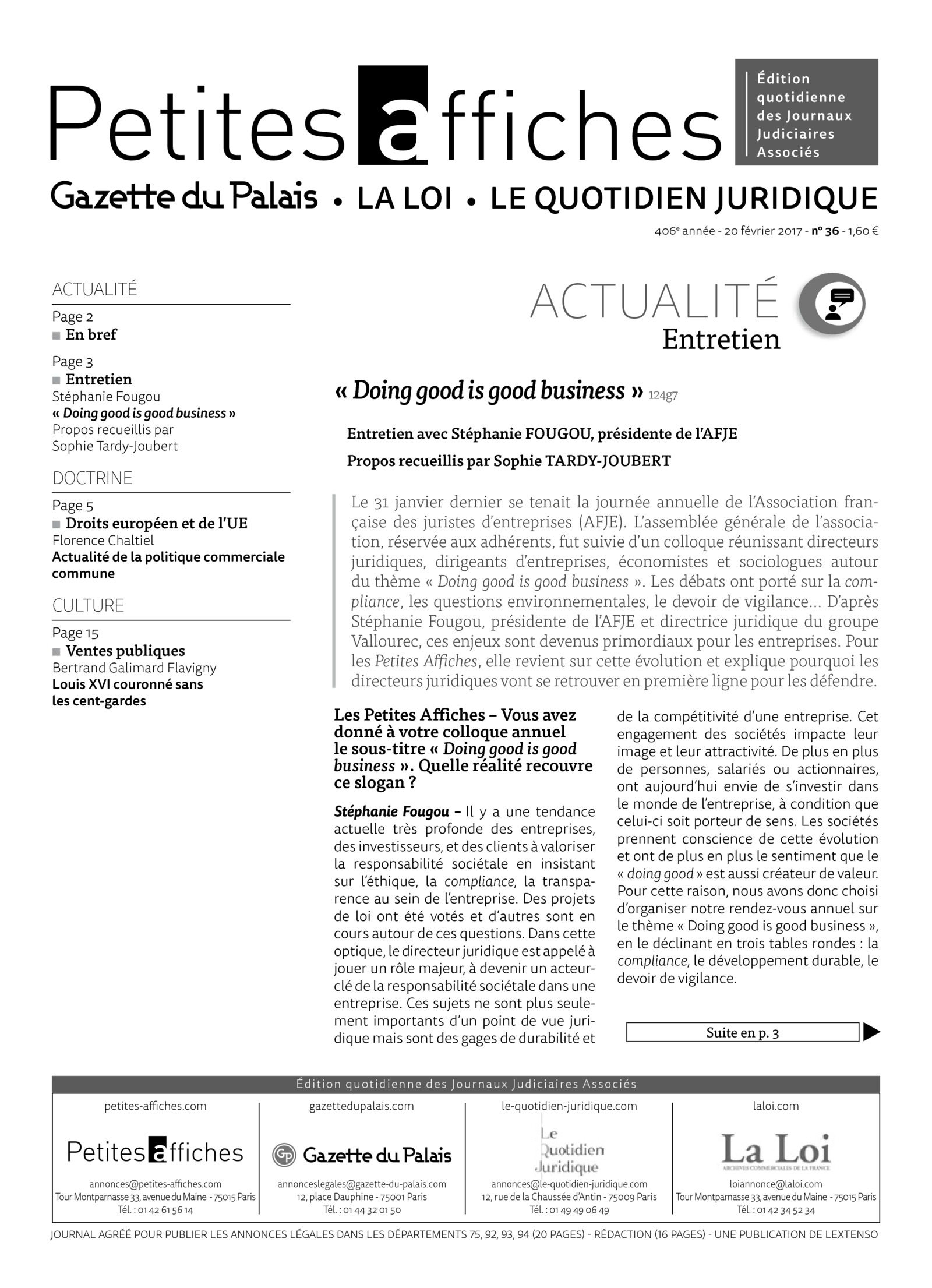Actualité de la politique commerciale commune
Première réalisation accomplie par la Communauté européenne, avec même quelques mois d’avance, en 1968, l’Union douanière sert de base à la politique commerciale commune contemporaine. Fondée sur une compétence exclusive de la Communauté – désormais de l’Union européenne – mais laissant quand même une part de marge de manœuvre aux États membres, la politique commerciale commune connaît de nouveaux développements et tourments dans le contexte des traités internationaux entre l’Europe et l’Amérique du Nord.
Selon le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la politique commerciale commune doit contribuer « au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu’à la réduction des barrières douanières et autres » (article 206 TFUE). Les débats animés sur les traités en préparation avec l’Amérique du Nord montrent que les développements ne sont pas d’emblée harmonieux. Elle est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux, l’uniformisation des mesures de libération, la politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale.
La Commission, pour la mise en œuvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil. Le traité de Lisbonne a élargi le champ de la politique commerciale commune et modifié l’équilibre institutionnel. Fondée à l’origine sur la libéralisation du marché des produits, puis des services, la compétence de la Commission s’est élargie au domaine de l’investissement. Le traité de Lisbonne voit par ailleurs l’émergence du Parlement européen dans le processus de codécision.
La politique commerciale commune repose sur l’union douanière qui implique non seulement liberté de circulation des marchandises entre les États membres, mais encore une politique douanière commune envers les États tiers. Afin de mettre en place un régime commun d’importation, un tarif douanier commun (TDC) à tous les États membres a été institué. Il s’applique aux importations de marchandises qui franchissent les frontières extérieures de l’union douanière, et diffère selon le bien et sa provenance. Le TDC peut être modifié ou suspendu suivant deux modalités. Soit le Conseil en décide à la majorité qualifiée, soit la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l’autorise à entamer des négociations tarifaires avec un ou plusieurs États ou des organisations internationales. L’Union fixe aussi des règles communes vis-à-vis des États tiers. Cette politique est fondée sur une compétence exclusive de l’Union européenne sans pour autant empêcher une certaine marge de manœuvre des États (I), qui n’hésitent pas à la revendiquer et l’utiliser dans le cadre des négociations internationales menées par l’Union européenne en tant que sujet de droit international avec ses partenaires commerciaux (II).
I – La politique commerciale commune, compétence exclusive de l’Union, présence des États
Si l’Union douanière appelait nécessairement une compétence exclusive de la communauté pour fixer les règles de fonctionnement de celle-ci, et notamment la fixation du tarif douanier commun, la dimension internationale de la politique commerciale n’entraînait pas nécessairement une compétence exclusive de la Communauté, puis de l’Union. Pourtant, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a tôt fait de reconnaître le principe du parallélisme des compétences internes et externes de la Communauté puis de l’Union. Le principe est aussi simple qu’essentiel à la bonne réussite du projet européen. La simplicité initiale a pu se complexifier au gré des négociations internationales et de la possibilité d’intérêts divergents entre États membres d’une part et entre certains États membres de l’Union et l’Union européenne d’autre part.
Le principe du parallélisme des compétences internes et externes, exprimés précocement dans l’arrêt dit AETR de 1971, signifie que lorsque l’Union s’est vue attribuer une compétence interne, elle dispose aussi, en vertu de ce principe, de l’équivalent de la compétence concernée au plan international. Dans l’arrêt Commission c/Conseil du 31 mars 1971 (AETR, 22/70), à propos d’un accord international en matière de transport, la Cour a établi le principe de parallélisme des compétences internes et externes, selon lequel à la compétence de définir une politique commune correspond la compétence de conclure des accords internationaux dans ce domaine. Le régime des mesures internes à la Communauté est lié à celui des relations extérieures (avis 1/76 du 26 avril 1977). La Cour reconnaît ainsi le principe du caractère évolutif des compétences communautaires dans les relations extérieures. C’est d’ailleurs par cette approche et cette philosophie que la Communauté, puis l’Union, se sont construites comme des acteurs internationaux et reconnues comme sujets de droit international. Précisons, et nous ne mentionneront désormais plus que celle-ci dans les développements qui suivent, que l’Union européenne, après avoir été créée en plus de la Communauté, a désormais succédé à cette dernière.
Les pays membres de l’Union européenne ont considéré que la libéralisation maîtrisée du commerce des biens, des services et des investissements était de nature à assurer la croissance des échanges et la prospérité de l’Union. La diminution des barrières douanières est censée permettre, à moindre coût, d’exporter les biens et services produits par les États membres, mais aussi d’importer des éléments à faible valeur ajoutée depuis les États tiers pour pouvoir ensuite exporter des produits finis à plus forte teneur technologique.
Rappelons qu’en vertu du traité de Lisbonne, une rationalisation de la répartition des compétences a été mise en place. On distingue les compétences partagées qui sont, en nombre, les plus importantes, les compétences exclusives, moins nombreuses, dont la politique commerciale commune, et des compétences subsidiaires ou d’appoint. Selon l’article 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union dispose d’une compétence exclusive dans les domaines suivants : l’union douanière ; l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ; la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro ; la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ; la politique commerciale commune.
L’Union dispose également d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union, ou est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.
Cependant, la politique commerciale comporte une dimension qui peut toucher à des aspects relevant de la souveraineté des États ou de leur identité, et pour lesquels l’idée d’une compétence internationale exclusive a pu porter à discussion. La notion d’accords mixtes a ainsi été admise (B) sur la base des principes de négociations commerciales internationales (A).
A – Les principes de négociations commerciales internationales
La définition du cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale obéit à la procédure législative ordinaire : elle relève donc du Conseil de l’UE et du Parlement européen ou auprès des organisations internationales comme l’OMC.
La compétence exclusive de l’Union inclut les négociations sur les accords commerciaux, sur les services y compris culturels et audiovisuels, d’éducation, sociaux et de santé humaine, les accords ayant trait à la propriété intellectuelle, et les investissements directs à l’étranger. La Commission travaille néanmoins en consultation étroite avec les États membres via le Conseil de l’UE puisqu’elle doit lui présenter des recommandations avant d’être autorisée à ouvrir les négociations nécessaires. En outre, ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec le « Comité 207 » qui comprend des représentants des 28 États membres1 et de la Commission européenne. Le Parlement européen doit également être tenu informé régulièrement de l’état d’avancement des négociations.
La politique commerciale de l’UE repose ensuite sur des règles commerciales communes vis-à-vis de l’extérieur. Des règles communes régissent notamment les accords commerciaux, l’uniformisation des mesures de libération, la politique d’exportation et les mesures de défense commerciale. Majoritairement, les échanges extérieurs de l’Union européenne sont régis par les accords multilatéraux négociés au sein de l’OMC.
Enfin, les accords sont, à l’issue des négociations internationales, signés et ratifiés par le Conseil de l’UE, et nécessitent l’approbation du Parlement européen. Il importe de souligner que le traité de Lisbonne renforce les pouvoirs du Parlement européen en matière de politique commerciale commune.
Les accords de Marrakech (1994) limitent l’utilisation d’instruments qui freinent ou qui ont des effets de distorsion sur les échanges agricoles (protection aux frontières, subventions à l’exportation et certaines politiques de soutien). Bien que les réformes de la PAC se soient concentrées sur la réduction des subventions à l’exportation, le soutien direct aux agriculteurs fait figure d’exception au sein des règles de l’OMC (« boîte verte »), tandis que les taxes à l’importation restent de fait élevées (près de trois fois plus que pour les autres secteurs).
La méthode est intégrée non seulement au regard de la nature exclusive de la compétence de l’Union, mais aussi au regard des modalités de vote au Conseil qui sont en principe celles régies par le principe de majorité. Le principe d’unanimité demeure néanmoins dans les domaines le plus sensibles ou le plus proches de la souveraineté.
L’importation dans l’UE de produits provenant de pays tiers n’est soumise à aucune restriction quantitative. L’UE dispose néanmoins d’instruments dits de « défense commerciale », qui visent à garantir un commerce équitable et à défendre les intérêts des entreprises européennes, conformément aux accords de l’OMC qui reconnaît à ses membres le droit de se prémunir contre des pratiques déloyales.
Le tarif douanier commun témoigne de l’existence d’une entité européenne identifiée vis-à-vis de l’extérieur. Ce tarif peut être modifié – voire suspendu – suivant deux types de procédures. Le Conseil de l’Union dispose d’un pouvoir de décision, selon le vote à la majorité qualifiée. La Commission, conformément à son pouvoir d’initiative, peut faire des propositions en ce sens au Conseil qui l’autorise, le cas échéant, à ouvrir des négociations tarifaires avec des États ou organisations internationales.
Il faut encore préciser l’existence de ce que l’on appelle le schéma de préférence généralisé ». Le principe du système des préférences généralisées (SPG) a été approuvé à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et constitue une facilité octroyée aux pays en développement (les « pays bénéficiaires ») par certains pays développés (les « pays donateurs »). Il ne résulte pas d’une négociation : le traitement préférentiel est non réciproque.
Les régimes SPG offerts par les différents pays donateurs et leurs règles d’origine diffèrent fondamentalement. Les marchandises se conformant aux conditions du SPG des États-Unis, par exemple, ne se conformeront pas nécessairement à celles du SPG de l’Union européenne.
Des régimes particuliers ont été établis afin de répondre aux besoins particuliers des pays les moins avancés. À la suite de l’initiative dite « Tout sauf les armes » (TSA), adoptée en 2001 dans laquelle, depuis 2001, l’Union a ouvert entièrement son marché aux exportations des pays les moins avancés, le SPG de l’UE octroie à ces pays un accès en franchise et sans contingent pour toutes leurs exportations. Depuis le 1er janvier 2011, cette distinction concernant les pays les moins avancés est mise en œuvre dans les règles d’origine du SPG de l’UE2.
En principe les importations dans l’Union ne sont soumises à aucune restriction quantitative. L’UE dispose néanmoins d’instruments dits de « défense commerciale », qui visent à défendre les intérêts des entreprises européennes, conformément aux accords de l’OMC qui reconnaît à ses membres le droit de se prémunir contre les pratiques déloyales. C’est ce que l’on appelle notamment les mesures anti-dumping. On en dénombre plus d’une centaine, la moitié environ concernant la Chine.
Il peut s’agir de mesures antisubventions. Par exemple lorsque la Commission est convaincue qu’un produit importé est subventionné par son État d’origine, elle peut recourir à ce qu’on appelle des droits compensatoires. En cas de prix de vente pratiqué sur un marché national inférieur au coût de production, la Commission peut aussi frapper les produits en cause de droits compensateurs à la demande d’une entreprise lésée. C’est un ensemble de mesures qui entrent dans la politique de l’anti-dumping.
Il peut aussi être décidé de mesures de sauvegarde : à la demande d’un ou plusieurs États membres ou de sa propre initiative, la Commission peut temporairement restreindre les importations d’un produit si un secteur est en difficulté, ou restreindre les exportations en cas de pénurie exceptionnelle sur le territoire de l’Union.
L’Union joue un rôle essentiel au sein de l’OMC : l’Union y promeut traditionnellement ses intérêts et ceux des États membres, par ailleurs membres de l’OMC à titre individuel. La Commission a aussi régulièrement recours à l’Organisme de règlement des différends pour arbitrer les litiges opposant un ou plusieurs États membres à leurs partenaires commerciaux.
L’Union, en tant que sujet de droit international, passe une série d’accords commerciaux, ou encore d’accords comportant un volet commercial avec un grand nombre de pays : par exemple, les États du bassin méditerranéen ; accords d’association et de libre-échange avec les pays d’Europe de l’Est ; accords de libre-échange avec la Corée du Sud, le Mexique, le Chili, l’Afrique du Sud et plusieurs pays d’Amérique centrale et du sud ; accords de partenariat économique (APE) avec les pays de la zone ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique). Elle passe aussi des accords sectoriels avec les États-Unis et le Japon.
Des négociations sont aussi régulièrement en cours avec plusieurs États tiers et organisations régionales comme l’ASEAN ou le MERCOSUR.
Les échecs rencontrés lors des négociations multilatérales sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce a conduit l’Union à développer une politique d’accords bilatéraux. L’ensemble des continents est concerné par cette politique. Les accords portent à la fois sur des réductions de droits de douane, mais aussi sur l’accès développé aux services, la réduction des barrières non tarifaires, comme par exemple les normes sanitaires, un meilleur accès au marché publics, la protection de la propriété intellectuelle ou encore la promotion de la politique du développement durable.
Les domaines les plus sensibles ont donné lieu à des réflexions sur la notion même de compétence exclusive, conduisant à l’admission de la notion d’accords mixtes.
B – Les accords mixtes en matière commerciale
La notion d’accord mixte concerne les accords internationaux qui portent sur des domaines relevant à la fois de la compétence de l’Union européenne et de la compétence des États membres. La négociation, comme les processus d’approbation et de ratification se déroulent donc non seulement à l’échelle de l’Union européenne, et en suivant le processus décisionnel applicable à la politique commerciale commune et les processus nationaux de ratification des traités.
Ainsi on parlera d’un accord mixte lorsque celui-ci concerne un des domaines dans lequel l’Union européenne partage ses compétences avec les États membres (TFUE, art. 4). Dans ce cas, l’accord est conclu à la fois par l’UE et par les États membres qui doivent donner leur accord.
Après la conclusion des négociations de l’accord entre l’UE et Singapour en octobre 20143, l’idée que les accords commerciaux relèvent de la compétence exclusive de l’UE a été remise en question. Par souci de clarification et de sécurité juridique, la Commission a sollicité l’avis de la Cour de justice sur la nature de l’accord UE-Singapour.
Pour leur part, les États membres souhaitent la participation formelle des parlements nationaux. Lors d’une réunion du Conseil, les conclusions précisent que les délégations nationales considèrent les accords avec Singapour ou le Canada de nature mixte. Selon eux, le contenu des accords concerne des compétences partagées, voire exclusives. Comme l’a souligné la commissaire, Cecilia Malmström, en réponse au Parlement européen le 19 mai 2015, il faudra tirer des conséquences de l’avis de la Cour concernant la mixité ou non de l’accord UE-Singapour. Cela déterminera la suite des négociations et du processus de ratification des accords avec le Canada (CETA) et par extension de l’accord actuellement discuté avec les États-Unis (TTIP) mais également les prochaines négociations.
Dans l’attente des conclusions de la Cour, la Commission considère juridiquement comme exclusive la compétence pour négocier les accords y compris sur le volet controversé des investissements mais suggère que certaines négociations puissent être mixtes pour des raisons « politiques ». C’est le cas de l’accord négocié avec le Canada qui illustre les difficultés liées à la ratification à l’unanimité des États membres et des parlements nationaux. Le risque majeur est la polarisation des accords commerciaux sous l’angle de menace de veto et d’approches contradictoires qui accentuent les appréhensions et craintes du citoyen. Les débats s’articulent autour d’une opposition de fait et moins sur des modifications spécifiques généralement déjà intégrées parmi les exceptions lors du mandat. Dans le cadre du CETA, le 23 septembre, les ministres du Commerce ont soutenu lors d’une réunion informelle les conclusions de l’accord avec le Canada, le premier avec un membre du G74. Pourtant, dans les semaines et mois précédents, plusieurs États menaçaient d’opposer leur veto à sept années de négociations pour des raisons variées : l’Autriche sur les tribunaux d’arbitrage, la Roumanie et la Bulgarie sur la non-suppression des visas à leurs ressortissants ou la Belgique car le soutien du parlement wallon – soit 0,7 % de la population européenne – est nécessaire au gouvernement fédéral et lui a été refusé le 14 octobre 2016.
Ce cas illustre la difficulté de réunir l’unanimité des parlements nationaux indépendamment des jeux diplomatiques traditionnels récurrents dans chaque négociation. Dans le cadre des accords de libre-échange, le Parlement européen représente les citoyens lors d’un vote de soutien ou de rejet. Cette compétence renforcée par l’article 218.6 du traité de Lisbonne était d’ailleurs une réelle avancée pour accompagner les négociations (grâce à des résolutions non législatives mais à la portée politique certaine) en brandissant la menace d’un veto s’ils n’étaient pas entendus. De plus, la règle de l’unanimité de plus de 385 parlements nationaux soulève la question de conflits de légitimité démocratique : un Parlement national représentant moins de 1 % de la population européenne peut rejeter un accord soutenu par tous les autres6.
Sans résoudre définitivement la question des accords mixtes, il faut rappeler que la Cour de justice avait, déjà au début des années 1990, la spécificité des questions relatives aux services et à la propriété intellectuelle, dans le cadre des accords commerciaux internationaux. Il s’agit de l’avis dit « GATS et TRIPS »7. La Cour indique alors que compte tenu de l’évolution du commerce international, attestée par l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et ses annexes, dont l’Accord général sur le commerce des services (GATS), qui ont fait l’objet d’une négociation d’ensemble englobant marchandises et services, le caractère ouvert de la politique commerciale commune s’oppose à ce que le commerce des services soit exclu d’emblée et par principe du champ d’application de l’article 113 du traité (dans la numérotation de l’époque des avis GATS et TRIPS).
Pour ce qui est de la fourniture transfrontalière qui n’implique aucun déplacement de personnes, le service est rendu par un prestataire établi dans un pays déterminé à un bénéficiaire résidant dans un autre pays. Il n’y a ni déplacement du prestataire vers le pays du bénéficiaire ni, en sens inverse, déplacement du bénéficiaire vers le pays du prestataire. Cette situation n’est pas sans analogie avec un échange de marchandises, lequel relève de la politique commerciale commune au sens du traité. Aucune raison particulière ne s’oppose donc à ce qu’une telle prestation entre dans la notion de politique commerciale commune.
Il n’en va pas de même des trois autres modes de fourniture de services visés par le GATS : la consommation à l’étranger qui comporte le déplacement du bénéficiaire vers le territoire du membre de l’OMC où le prestataire est établi ; la présence commerciale, c’est-à-dire la présence d’une filiale ou d’une succursale sur le territoire du membre de l’OMC où le service doit être rendu ; la présence de personnes physiques d’un membre de l’OMC grâce auxquelles un prestataire d’un membre fournit des services sur le territoire de tout autre membre.
Pour ce qui est des personnes physiques, il ressort de l’article 3 du traité qui distingue, dans sa lettre b, « une politique commerciale commune » et, dans sa lettre d, « des mesures relatives à l’entrée et à la circulation des personnes », que le traitement des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres ne saurait être considéré comme relevant de la politique commerciale commune. De manière plus générale, l’existence dans le traité de chapitres spécifiques consacrés à la libre circulation des personnes, tant physiques que morales, fait apparaître que ces matières ne sont pas englobées dans la politique commerciale commune.
Il en résulte que les modes de fourniture de services que le GATS appelle « consommation à l’étranger », « présence commerciale » et « présence de personnes physiques » ne sont pas couverts par la politique commerciale commune.
La Cour souligne que les services particuliers que constituent les transports font l’objet, dans le traité, d’un titre spécial, distinct du titre qui est consacré à la politique commerciale commune, de sorte que les accords internationaux en matière de transports ne relèvent pas de l’article 113 du traité (numérotation de l’époque des avis TRIPS et GATS), nonobstant le fait qu’une série de mesures d’embargo arrêtées par le Conseil et la Commission, qui ont été fondées sur l’article 113, comportaient l’interruption des transports. En effet, l’embargo portant d’abord sur l’exportation et l’importation des produits, il n’aurait pu être effectif s’il n’avait pas été accompagné de l’accessoire nécessaire que constituait l’interruption des transports.
La Cour rappelle qu’une simple pratique du Conseil n’est pas susceptible de déroger aux règles du traité et ne peut, par conséquent, créer un précédent liant les institutions de la Communauté lorsque, préalablement à l’adoption d’une mesure, il leur appartient de déterminer la base juridique correcte à cet effet.
La Cour précise que dans la mesure où la section de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC, en anglais, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights :TRIPS), relative aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, contient des prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière, le TRIPS trouve son pendant dans les dispositions du règlement n° 3842/86 du Conseil fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon. Ce type de mesures pouvant être adopté de façon autonome sur la base de l’article 113 du traité CE, des accords internationaux ayant le même objet relèvent de la compétence de la Communauté en matière de politique commerciale.
S’agissant des dispositions du TRIPS autres que celles qui concernent l’interdiction de la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon, la Cour estime alors que le lien entre la propriété intellectuelle et le commerce des marchandises, tenant à ce que les droits de propriété intellectuelle permettent à leurs titulaires d’empêcher d’accomplir certains actes produisant des effets sur ce commerce, n’est pas suffisant pour faire entrer lesdits droits dans le champ de l’article 113 du traité8.
S’agissant de la propriété intellectuelle, la cour estime, toujours dans cet avis de 1994, qu’il n’est pas contestable que, lorsque la compétence d’harmonisation conférée par l’article 100 A du traité a été exercée, les mesures d’harmonisation ainsi arrêtées peuvent limiter la liberté des États membres de négocier avec des pays tiers, voire la leur enlever. Mais il est exclu qu’une compétence d’harmonisation sur le plan interne, qui n’a pas été mise en œuvre dans un domaine déterminé, puisse aboutir à créer, en faveur de la Communauté, un titre de compétence exclusive, sur le plan externe, dans ce domaine.
Il en va de même pour l’article 235 du traité (numérotation de l’époque), qui, s’il permet à la Communauté de remédier aux insuffisances des pouvoirs qui lui sont conférés, explicitement ou implicitement, en vue de la réalisation de ses objectifs, ne peut créer comme tel un titre de compétence exclusive de la Communauté sur le plan international.
En matière de propriété intellectuelle, l’harmonisation réalisée dans le cadre communautaire est, s’agissant des domaines couverts par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPS), soit partielle, soit inexistante. En ce qui concerne les mesures à prendre pour garantir une protection efficace des droits de propriété intellectuelle, la Communauté a certainement une compétence pour harmoniser les règles nationales sur ces sujets dans le cadre de l’article 100 du traité, mais, jusqu’ici, les institutions communautaires n’ont presque pas exercé leurs compétences en ce domaine. Il en résulte que la Communauté et les États membres ont une compétence partagée pour conclure le TRIPS9.
D’ailleurs, la question se pose de la nature des accords internationaux actuellement en cours de discussion. Sur le plan juridique, seul l’UE est compétente sur les domaines couverts par l’accord CETA. « Mais nous avons proposé un statut mixte car il n’y avait pas d’accord du côté des États membres » a expliqué la commissaire européenne au commerce Cecilia Malmström lors d’une conférence de presse à Strasbourg10.
II – Enjeux des négociations commerciales internationales
Deux traités en cours de négociations ont particulièrement retenu l’attention des politiques, des médias et des juristes, afin d’en démêler les contenus complexes. Le TAFTA et le CETA.
Le premier est un projet de traité avec les États-Unis. Le projet d’accord commercial entre l’Union européenne et les États-Unis est appelé de différentes façons. Son nom officiel en français est Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI), mais on utilise généralement l’acronyme anglais TTIP pour Transatlantic Trade and Investment Partnership11.
On peut noter que les opposants au traité ont plutôt tendance à employer l’ancienne dénomination TAFTA (pour Transatlantic Free Trade Area, ou Traité de libre-échange transatlantique), probablement pour sa ressemblance phonétique avec le traité ACTA : un autre accord commercial qui avait été rejeté en 2012 par le Parlement européen.
Les négociations entre l’Union européenne et les États-Unis ont commencé suite à la publication, quelques mois plus tôt, du rapport « Reducing Translatlantic Barriers to Trade and Investment » du Centre for Economic and Policy Research (CEPR), un think tank basé à Londres12.
Les objectifs nombreux et affichés ne sauraient cacher une série de difficultés qui suscitent des tensions au sein de l’Union d’une part et entre l’Union et ses États membres d’autre part. Rappelons d’abord quelques éléments chiffrés. Avec une population cumulée de plus de 800 millions de personnes, les États-Unis et l’Union européenne sont les deux plus grandes économies du monde. Elles représentent ensemble plus de 40 % du commerce mondial.
L’histoire du commerce international, dans son volet le plus récent, montre que les barrières tarifaires sont d’ores et déjà très faibles entre les deux parties – avec un tarif douanier d’environ 3 % des États-Unis vers l’Europe et 2 % dans l’autre sens. Cependant, le TTIP vise à éliminer définitivement les dernières barrières tarifaires et réglementaires entre ces deux marchés, en étendant la réglementation aux domaines non couverts par l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
L’objectif est aussi affiché de renforcer les liens entre l’Union européenne et les États-Unis de sorte de maintenir une influence mondiale face aux puissances concurrentes et des économies émergentes.
Conformément au traité de Lisbonne, les États membres ont donné mandat à la Commission européenne pour mener les négociations du TTIP. Le document expose les principes généraux et les objectifs qui doivent structurer le processus. Le nombre de thèmes à aborder est très grand. C’est pour tenir compte du très grand nombre de sujets que les négociations se déroulent depuis 2013 en plusieurs étapes ou, pour employer les termes consacrés dans les négociations commerciales internationales, « rounds », la 15e série ayant eu lieu du 3 au 7 octobre 2016.
Du côté européen, les négociations sont prises en charge par la Direction générale du commerce (DG TRADE) sous la direction de Cecilia Malmström, commissaire européenne au Commerce. Le négociateur en chef pour l’UE est Ignacio Garcia Bercero. Du côté américain, c’est le USTR (United States Trade Representative) Michael Froman qui mène les négociations. L’accord final devra être approuvé et ratifié à l’unanimité par les États membres, ainsi que par le Parlement européen et le Conseil13.
Le traité suscite de nombreux débats relatifs notamment aux conséquences économiques et sociales de son éventuelle ratification et mise en œuvre.
Selon la Commission européenne et une étude du CEPS (Centre d’étude et de prospective stratégique), publiée en octobre 2014, le TTIP pourrait faire croître l’économie européenne de 120 milliards d’euros (0,5 % du PIB) et l’économie américaine de 95 milliards d’euros (0,4 % du PIB). Cependant, ces prévisions qui apparaissent, de prime abord, favorable aux deux parties, ne suffisent pas à convaincre, non seulement de la fiabilité de telles projections mais aussi de la capacité de ces prévisions à emporter l’adhésion par rapport aux réticences que suscite le traité.
Ainsi, par exemple, quant à fiabilité des études conduites, on peut citer une étude de la Tufts University qui prévoit un taux de croissance faible voire négatif. Il est aussi à craindre que certains secteurs subissent une forte perte d’emplois, par exemple les exportateurs européens de viande et de machines, comme l’explique le site du gouvernement néerlandais. Reste à observer comment une telle réorientation économique peut se dérouler14.
Les différences entre les normes européennes et américaines suscitent également des débats difficiles à résoudre. En principe, la définition de règles pour les échanges entre Europe et États-Unis pourrait encourager d’autres pays à y adhérer. Le partenariat pourrait également renforcer et transmettre des valeurs communes comme les droits de l’Homme, la transparence ou encore la protection environnementale. Cependant, l’hétérogénéité des systèmes normatifs rend périlleuse la réussite du projet. La nature fédérale des États-Unis, avec la répartition des compétences existant entre le niveau fédéral et le niveau fédéré, engendre des distorsions de législations. Certaines législations sont ainsi souvent plus libérales en ce qui concerne la santé, l’environnement, les normes sanitaires et les produits chimiques, notamment. Or il s’agit de sujets d’importance majeure, sur lesquels plusieurs États dont la France, commencent à poser des hypothèques. L’hétérogénéité de la législation américaine est indéniablement un facteur de complexité des échanges dans le cadre d’un tel traité. Tous les domaines sont concernés par la difficulté, que l’on pense à la variété des exportations ou encore à la complexité des règles régissant les marchés publics.
Le domaine environnemental et sanitaire est particulièrement sensible. L’Union européenne a fondé sa législation en la matière sur le principe de précaution, quand les États-Unis ont une tradition plutôt ancrée sur le principe de réparation. Pour la première, des contrôles nombreux en amont sont prévus, et l’ensemble des États membres sont sur cette ligne. En revanche, les États-Unis, en vertu du principe de réparation, ont plutôt une tradition fondée sur la réparation des dommages une fois ceux-ci survenus. De cette distinction schématique, la crainte s’est développée de la potentielle exportation (rejetée par la Commission européenne) vers le marché européen de bœuf aux hormones, de poulet au chlore ou encore d’OGM suscite d’ardentes polémiques.
Le délicat débat autour de la notion d’arbitrage est aussi un sujet de discorde. Sur ce point, l’écart entre la position de l’Union européenne et une série d’associations ainsi que des États membres apparaît avec acuité. Il s’agit de ce qu’on appelle les arbitrages investisseur-État.
Le mécanisme prévu vise à protéger les entreprises qui investissent à l’étranger contre des « décisions arbitraires voire illégales ». Mais le fait que les entreprises puissent intenter des procès contre des États suscite de fortes préoccupations auprès de ce qui peut témoigner de l’émergence d’une opinion publique européenne, comme américaine, qui y voit une augmentation du pouvoir des multinationales face aux États souverains.
Enfin, les tentatives pour trouver un équilibre entre la transparence demandée par l’opinion publique et la confidentialité nécessaire vient également compliquer les négociations sur le TTIP. La Commission a publié sur son site les textes de négociation ainsi que d’autres documents pertinents concernant les différents « rounds ». Elle prévient toutefois qu’une transparence absolue est impossible, un négociateur ne pouvant pas dévoiler toutes ses cartes à l’avance. Par ailleurs, les États-Unis sont bien moins transparents que l’Union européenne sur ses objectifs de négociation.
En revanche, le fait que les conditions de consultation des documents soient extrêmement strictes, y compris pour les députés européens, suscite des craintes concernant ce qui apparaît comme des négociations peu visibles ni lisibles et l’influence des multinationales dans les négociations. Les « Leaks »15 de Greenpeace Pays-Bas en mai 2016 n’ont fait qu’alimenter ces critiques16.
Le 28 août 2016, le gouvernement allemand a annoncé un « échec de facto » des négociations, suivi deux jours plus tard par la France, qui s’est déclarée contre un traité jugé en l’état trop favorable aux intérêts américains au détriment de l’UE. La société civile européenne se mobilise elle aussi depuis longtemps contre cet accord. Enfin, l’échec possible du CETA, deuxième traité, actuellement en cours de discussion, pourrait aussi être perçu comme un signal très fort sur l’avenir du TTIP. Le traité CETA, qui concerne cette fois le Canada, témoigne, lui aussi, des difficultés actuelles du volet externe de la politique commerciale commune.
Le second est en effet un projet de traité avec le Canada. Il s’agit d’un accord commercial bilatéral de l’Union européenne avec une grande puissance économique, qui apparaît comme novateur et ambitieux. Souvent associé au TAFTA, il suscite lui aussi de nombreuses critiques17.
L’Accord économique et commercial global (AEGC) entre l’Union européenne et le Canada (CETA) est dit de « nouvelle génération ». Il réduit drastiquement les barrières tarifaires et non-tarifaires, mais traite également de nombreux aspects liés à l’exportation de biens et de services et à la mise en place d’un cadre d’investissement stable et favorable aux entreprises européennes et canadiennes.
En pratique, il réduira la quasi-totalité – près de 99 % – des barrières d’importations, permettra aux entreprises canadiennes et européennes de participer aux marchés publics, de services et d’investissements de l’autre partenaire et renforcera la coopération entre le Canada et l’UE en termes de normalisation et de régulation.
Les négociations du CETA ne sont pas récentes puisqu’elles ont débuté le 6 mai 2009 au sommet UE-Canada de Prague. Elles font suite à la publication, en octobre 2008, de l’étude « Assessing the Costs and Benefits of a Closer EU-Canada Economic Partnership », conjointement menée par la Commission européenne et le gouvernement canadien, qui met en valeur les larges bénéfices économiques possibles résultant d’un accord bilatéral. Les deux partenaires économiques ont présenté le CETA le 26 septembre 2014 lors d’un sommet à Ottawa, et ont proclamé la conclusion des négociations.
En juillet 2016, la Commission européenne a adopté le texte du traité – après traduction en 23 langues et révision juridique – et a formellement proposé au Conseil de l’Union de le signer et le conclure. L’accord n’est pourtant pas encore juridiquement applicable.
Le 27 octobre 2016, les 28 pays de l’UE devaient en effet signer le CETA. L’entrée en vigueur du traité dépend en effet des signatures des États membres et de l’approbation du Parlement européen. Mais suite au refus de la Wallonie d’autoriser la Belgique à ratifier l’accord, le sommet qui devait accueillir sa signature a été annulé. Les entités belges ayant finalement trouvé un accord dans la semaine, la signature a pu avoir lieu le 30 octobre. Paul Magnette, spécialiste du droit européen et ministre-président de la Wallonie, avait été particulièrement présent pour expliquer les enjeux du traité.
Le traité pourra ainsi entrer en vigueur de façon provisoire (en excluant certains volets tels que les tribunaux d’arbitrage) une fois que le Parlement européen et le Parlement canadien l’auront approuvé. Ensuite, la ratification par les parlements nationaux et, pour certains États, des parlements régionaux, sera nécessaire à son entrée en vigueur définitive. Ainsi que la validation du mécanisme d’arbitrage par la Cour de justice de l’Union européenne. Le processus pourrait donc prendre encore quelques mois voire quelques années.
Le Canada est un partenaire commercial important de l’UE. Il est au 12e rang des relations commerciales de l’Union européenne, tandis que l’UE est le deuxième partenaire commercial du Canada – après les États-Unis. Le volume des échanges de biens entre les deux partenaires s’élève à près de 60 milliards d’euros par an – l’UE exportant principalement des machines, des équipements de transport et des produits chimiques vers le Canada. Les services commerciaux représentent quant à eux près de 26 milliards d’euros (en 2012) – principalement des services de transports, de voyage et d’assurance.
Le Canada et l’UE entretiennent également une relation étroite en termes d’investissements. Le Canada est le quatrième investisseur étranger dans l’UE – plus de 142 milliards d’euro (en 2012) – tandis que l’UE est le deuxième investisseur étranger au Canada – près de 260 milliards d’euros (en 2012).
Le CETA a donc pour objectif de renforcer ces liens commerciaux, mais aussi de créer un environnement plus stable pour soutenir les investissements entre les deux partenaires.
De plus, le Canada constitue une très importante réserve de ressources naturelles, énergétiques et de savoir-faire pour l’UE. Le traité bilatéral de libre-échange assure donc l’accès à des marchés économiques d’envergure pour les deux partenaires. Pour la Commission européenne, le CETA est étroitement lié à la volonté de stimuler la croissance européenne en renforçant la compétitivité des entreprises et en leur permettant de s’ouvrir à des marchés dynamiques et équitables.
La mise en œuvre du CETA permettrait aux États membres de l’UE de soutenir leur croissance par l’extension des marchés accessibles aux entreprises, la baisse des droits tarifaires, l’accession des marchés publics canadiens et l’échange soutenu de technologies et de savoir-faire. En conséquence, le traité favoriserait la création d’emplois et la compétitivité de l’UE tout en étant favorable aux consommateurs par des normes de qualités maintenues et des baisses de prix. La Commission européenne estime que le CETA devrait accroître de 25 % les échanges commerciaux UE-Canada et entraînerait une augmentation du PIB de l’UE de 12 milliards d’euros par an.
Le CETA éliminerait les droits de douane rapidement – la suppression complète est prévue sept ans après l’application du traité – pour une économie attendue de près de 600 millions d’euros par an. Cette mesure s’appliquerait à la quasi-totalité des secteurs d’activité ; l’agriculture maintiendrait des exceptions, mais 92 % des biens agricoles seraient concernés. La baisse des droits de douane permettrait aux entreprises européennes d’accéder aux consommateurs canadiens – à hauts revenus18.
Chaque année, le gouvernement canadien achète 30 millions d’euros de biens et de services à des entreprises privées. Les appels d’offres de ce marché public seraient dès lors ouverts aux entreprises européennes.
Le cadre stabilisé d’investissement favorisé par le traité permettrait de favoriser l’emploi en Europe. Les études économiques soutenant le CETA estiment que pour chaque milliard d’euros investi par l’UE, 14 000 emplois seraient créés.
Enfin, si de nombreux détracteurs du CETA déplorent que le traité remette en cause les normes européennes de qualité des produits, la Commission européenne avance que le Canada partage ses valeurs éthiques liées à la commercialisation de biens et services. Le CETA permettrait en outre de favoriser la coopération régulatrice des deux partenaires, et de permettre au consommateur d’accéder à un choix plus divers de biens et services sans sacrifier à la qualité de ceux-ci. À cela s’ajoute que le CETA prévoit de protéger les spécificités culturelles et traditionnelles des deux partenaires – par exemple en reconnaissant et protégeant plus d’une centaine d’appellations d’origine contrôlée (AOC) en France.
Malgré les nombreux bénéfices attendus de l’accord de libre-échange entre le Canada et l’UE, le CETA n’est pas exempt de critiques et soulève encore de nombreuses questions. Le blocage de trois gouvernements régionaux de Belgique (Wallonie, Bruxelles et Communauté linguistique francophone), qui refusent pour l’heure de donner le feu vert à leur gouvernement pour la ratification du traité, est symptomatique des réticences qui animent encore les partenaires sociaux et les producteurs locaux.
Le premier point de blocage concerne le règlement des différends. Le CETA prévoit qu’en cas de désaccord avec la politique publique menée par un État, une multinationale peut porter plainte devant un tribunal d’arbitrage international. Les Wallons s’inquiètent de ce mécanisme qui pourrait affaiblir le pouvoir régulateur des États membres en permettant la remise en cause des normes produites. La Commission européenne a dès lors tenté d’apaiser les esprits en transmettant aux Wallons un projet de déclaration visant à renforcer l’indépendance et l’impartialité de ce tribunal d’arbitrage.
Le second point de blocage porte sur l’impact de ce traité sur l’agriculture des États membres. Là encore, la Wallonie – comme de nombreuses ONG – est en tête de pont, arguant que les garanties de protection de l’agriculture locale sont insuffisantes. La crainte d’une remise en cause des modèles agricoles et agro-écologiques au contact du modèle canadien reste vive chez les producteurs européens – le principe de précaution n’existant pas au Canada. Cette réserve est en grande partie partagée par les agriculteurs français, qui déplorent le manque de reconnaissance des produits certifiés français – seule une centaine d’AOC reconnue sur les 561 que compte le territoire français.
Le processus de négociation du CETA s’est également attiré les critiques de la société civile dès la présentation du traité. La Commission européenne assure avoir établi un dialogue avec les partenaires sociaux et les parties prenantes dès le début des négociations. De nombreuses études d’impact – économiques comme de développement durable – ont été publiées et des consultations publiques effectuées. Les textes résultants des négociations sont de surcroît publiquement accessibles. Mais nombreuses sont les voix qui s’élèvent pour dénoncer le silence de Bruxelles et le processus opaque de négociation avec le gouvernement canadien. C’est une certaine opacité qui a ainsi été dénoncée. Le traité a été officiellement signé le 30 octobre. Le texte du CETA devra désormais être ratifié par le Parlement européen, sans doute au début de 2017, ce qui permettra une mise en œuvre provisoire et partielle. Ensuite, pas moins de 38 assemblées, nationales ou régionales, devront se prononcer dans les pays de l’Union. Des procédures qui pourraient prendre plusieurs années et semblent, désormais, pleines d’incertitudes : l’examen approfondi du texte initial par les Wallons va sans doute réveiller les ardeurs de certains parlementaires qui n’avaient, jusque-là, pas prêté une grande attention au CETA.
En Allemagne, le Bundestag devrait dire oui, les deux membres de la « grande coalition » y étant favorables. Au SPD, les opposants ont été mis en minorité à la suite d’un vote obtenu par Sigmar Gabriel, président du parti et ministre de l’Économie. Le Bundesrat devra également se prononcer selon une procédure qui n’est pas déterminée. L’une d’entre elles permettrait aux Verts et à Die Linke, qui participent à 12 gouvernements régionaux sur 16, de bloquer le processus.
En Autriche, où de fortes réticences se sont exprimées, le Parlement devrait adopter le CETA, même si les syndicats, très puissants, y sont encore opposés. Le parti ÖVP (conservateur) est aux commandes du ministère de l’Économie, mais le parti d’extrême droite FPÖ est contre le projet et réclame un référendum. Le Parlement devrait donc ratifier le texte rapidement, en tout cas avant les prochaines législatives anticipées que le FPÖ est presque sûr de remporter.
En Hongrie, le parti Fidesz du Premier ministre, Viktor Orbán, a longtemps entretenu le flou sur sa position. Il affiche désormais son soutien au texte, le gouvernement estimant finalement que l’accord bénéficiera aux entreprises hongroises19.
Comme on le constate, de nombreux processus sont en cours. Les négociations commerciales globales ont fait place à des négociations bilatérales, de grand bloc économique à grand bloc. Les États, s’ils jouent le jeu des traités, par les mandats de négociation qu’ils donnent à la Commission, comme le prescrivent les traités, n’entendent pas moins veiller à leurs intérêts. Ce faisant, on observe, et c’est sans doute une des réussites du projet européen en la matière, que les États, en veillant à sauvegarder les principes qui sont fondamentaux selon eux, s’inscrivent dans la philosophie des principes européens qu’ils ont contribué à forger, mais que, dans le même temps, les institutions européennes véhiculent et promeuvent désormais. Une identité européenne, peut être insuffisamment visible ou insuffisamment perçue comme telle, est bien à l’œuvre.
Notes de bas de pages
-
1.
La sortie de l’Union européenne du Royaume-Uni, « le Brexit », s’il a lieu, conduira à des négociations concernant les 27 et non les 28.
-
2.
Site de la Commission européenne.
-
3.
Les relations UE-Singapour sont fondées sur un accord de coopération conclu entre l’UE et l’ASEAN en 1980. L’Union européenne cherche depuis plusieurs années à renforcer sa relation avec les États membres de l’ASEAN, et notamment avec Singapour, par la conclusion d’accords de partenariat et de coopération (APC) ayant vocation à couvrir l’ensemble des relations de l’UE avec les États tiers (coopération en matière économique et commerciale, politique et sectorielle).
-
4.
Les négociations entre l’Union européenne et Singapour à propos d’un Accord de Partenariat et de Coopération se sont achevées le 1er juin 2013 et le document a été paraphé le 14 octobre 2013.
-
5.
Dans le cadre des perspectives budgétaires 2014-2020, Singapour n’est plus éligible aux programmes bilatéraux de l’ICD mais continue d’être éligibles aux programmes régionaux et thématiques de l’ICD et bénéficiera par ailleurs d’un nouvel instrument financier : l’Instrument de partenariat (doté à hauteur de 900 millions d’euros pour 2014-2020, dont 400 millions pour l’Asie). Un « Centre de l’Union européenne » a été inauguré en janvier 2009 à Singapour au sein de l’Université nationale de Singapour (NUS) et de l’Université technologique de Nanyang (NTU).
-
6.
L’Union européenne est le troisième partenaire commercial de Singapour (après la Chine et la Malaisie) et son premier investisseur. Le commerce bilatéral a représenté 45 milliards d’euros d’échanges en 2014. Singapour est le premier partenaire commercial de l’UE dans l’ASEAN.
-
7.
Un accord de libre-échange a été conclu, partiellement, en décembre 2012 avec Singapour, sa partie commerciale a été paraphée le 20 septembre 2013. Les négociations sur la partie investissements de l’accord ont été conclues en octobre 2014.
-
8.
Préc.
-
9.
Eu égard au bicamérisme de certains États membres.
-
10.
http://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0407-la-politique-commerciale-de-l-union-europeenne-au-risque-des-defis-internes.
-
11.
Avis de la Cour du 15 novembre 1994, 1/94.
-
12.
Avis préc.
-
13.
Avis préc.
-
14.
« Les États membres-reprennent la main sur le CETA », http://www.lemonde.fr/.
-
15.
http://www.touteleurope.eu/.
-
16.
V. http://www.lemonde.fr/.
-
17.
http://www.touteleurope.eu/, préc.
-
18.
Cité par l’étude de http://www.touteleurope.eu/.
-
19.
http://www.touteleurope.eu/.
-
20.
Préc.
-
21.
Préc.
-
22.
http://www.touteleurope.eu/.
-
23.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie-mondiale/article/2016/10/30/le-ceta-traite-de-libre-echange-entre-l-union-europeenne-et-le-canada-a-ete-signe-a-bruxelles_5022713_1656941.html#bSvseIxzRZVVsqAD.99.